len' a écrit : ↑ven. 1 mars 2024 16:32La zone d'intérêt de Jonathan Glazer
Je ne savais pas grand-chose du film, à part que ça évoquait la Shoah et que ça faisait beaucoup parler. Je n'avais pas non plus d'a priori sur Jonathan Glazer : sans les adorer, j'ai bien aimé l'esprit conceptuel de ses précédents films. On est toujours dans cet esprit, sauf qu'ici ça passe difficilement.
Dès le début, c'est le déballage de belles choses : un beau son, de belles images avec un mobilier authentique qui donnent l'impression d'y être et des scènes brillamment filmées (je pense à celle de la grand-mère dans sa chambre évoquée par cyborg ou rien que celle de la brouette poussée par un déporté). Et pourtant, je suis resté globalement indifférent et me suis même surpris à bâiller. Je me suis d'abord senti honteux, avant de finir par comprendre que j'assistais à une séance de thanatopraxie : le mort est soigneusement maquillé mais reste mort. Et quand je parle de mort, je parle de la mise en scène, pas du fait de ne pas montrer l'intérieur des camps. Par contre, j'aime la fin parce qu'elle met étrangement en lumière la vitrine qui imprègne tout le film. Et elle est vivante cette fin avec toutes ces mains qu'on voit et qui nettoient dans une sorte de cérémonie qu'on devine se répéter chaque jour. Il y a peut-être une interprétation plus sophistiquée à avoir, mais je ne préfère pas l'imaginer.
Comme on observe à travers une vitrine donc, Glazer filme de loin, tellement loin qu'il devient difficile de voir les personnages, dessinés en quelques gros traits. On met l'accent sur un quotidien, celui d'un ménage qui se préoccupe de son jardin tandis que l'horreur est de l'autre côté du mur (j'ai peur de la comparaison avec notre monde actuel). Le choix n'est jamais fait de suivre quelqu'un ou quelque chose plutôt qu'une autre, la mesure est la règle, il ne faudrait pas déborder. Je pense aussi à ces scènes où on voit à l'œuvre le fonctionnariat de l'abject, avec ses réunions, ses objectifs, sa hiérarchie. D'un côté c'est bien parce que c'est rarement abordé dans les films traitant de la Shoah sachant que c'est peu propice à de belles séquences cinématographiques et sûrement que ça dérange aussi. Mais là encore, ça reste limité (surtout que Jonathan Littell avait déjà développé plus longuement cette idée dans son livre les Bienveillantes). Même pour la durée du film, on est dans l'entre deux, il aurait pu être bien plus court ou plus long avec des choix plus affirmés. Ce n'est donc pas tant le concept initial qui me dérange que la manière qu'a Glazer de muséifier son film, de le coincer, avec ce sentiment constant d'avoir un guide qui me conduit calmement de vitrine en vitrine sans la possibilité de me perdre, de m'attarder ou de trébucher.
Le Centre de Visionnage : Films et débats
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
- groil_groil
- Messages : 3793
- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12
Salut ! pas de possibilité de voir des films en ce moment.
Ces derniers jours / semaines, seulement ça :
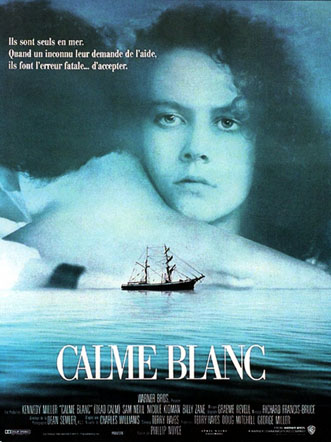
Revu après avoir parlé de la musique de SPK sur l'album Zamia Lehmanni avec un ami. Graeme Revell a quitté SPK après cet album sublime et a commencé à réaliser de la musique de film pour Hollywood. C'est d'autant plus surprenant pour ce néo-zélandais qui pratiquait un indus extrême et radical de le voir se plier aux canons hollywoodiens. Mais il y a réussi et est devenu un compositeur prolixe et respecté. Deux vies en une. Bref, Calme Blanc est l'une de ses premières compos pour le cinéma (sa première ?) et ce qui est intéressant, c'est que le score, très réussi, utilise un thème de Zamia Lehmanni ce que ne manquaient pas de noter les fans d'indus à la sortie du film. A part ça, j'ai toujours adoré ce film, je le connais par coeur, c'est un thriller domestique maritime en forme de huis clos à 3 personnages, super tendu et hyper bien mis en scène (Noyce n'a jamais fait mieux). A revoir aujourd'hui on voit bien quelques tics des 90's un peu clichés et désagréables, mais ça ne gâche en rien le plaisir total de ce parfait divertissement du dimanche soir.

Jeremy-Paul Kagan est l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood. De lui je n'avais vu jusqu'à présent que The Big Fix, film extraordinaire, sorte de relecture débonnaire et très libre du Privé de Robert Altman, dans lequel Richard Dreyfuss trouvait peut-être son plus beau rôle. Surtout, la mise en scène du film est signe d'un très grand. Fou de joie donc, quand j'ai vu que ce Héros sortait en bluray. Héros est le premier film de Kagan, il était jusqu'à présent réalisateur pour la TV, officiait dans diverses séries, et c'est fou de constater que dès son premier film il réalise un chef-d'oeuvre. Casting de rêve, déjà : Henry Winckler, alias Fonzy, qu'il est précieux de voir dans un vrai film avec un vrai rôle, et de constater qu'il est un acteur merveilleux, plein d'humour et de nuances même dans la tragédie, une sorte de Dustin Hoffmann bis. Sally Field ensuite, une des plus grandes, aussi émouvante que dans sa trilogie avec Martin Ritt, c'est dire. Et le jeune Harrison Ford, en éleveur de lapins, vient compléter le trio. Je sais que je vais attirer l'attention en signifiant que c'est l'un des plus grands films méconnus du Nouvel Hollywood, et surtout que c'est, je crois, le premier film sorti concernant la Guerre du Vietnam et ses conséquences désastreuses (la sortie française est 1979 mais le film est de 1977). Oui, avant Coppola, avant Cimino, avant Hal Ashby (Héros fait beaucoup penser à Coming Home d'ailleurs, les films ont pas mal de points communs), avant tout le monde, on peut même dire que c'est Héros de Kagan qui a lancé cette grande vague de films sur le Vietnam, qui compte parmi les plus beaux films de cette époque. Celui-ci est vraiment de cette trempe, je ne vous en raconte pas l'histoire si attachante, mais disons qu'il s'agit d'un road movie très attachant, parfois très drôle, mais qui parle des conséquences traumatiques de la Guerre du Vietnam sur un jeune homme marqué à vie parce qu'il a vécu. C'est bouleversant, mis en scène avec une intelligence et une aisance rares, et comme beaucoup de grands films, ça croise les genres pour aller de la comédie au drame, du road movie au mélodrame, bref, c'est à découvrir d'urgence, comme le reste de l'oeuvre de ce grand cinéaste méconnu.
Ces derniers jours / semaines, seulement ça :
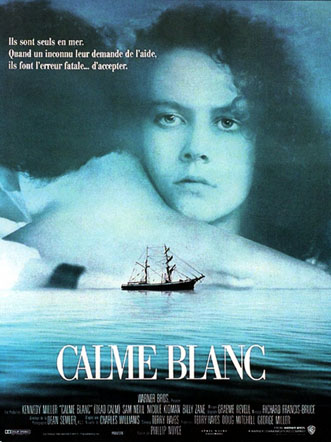
Revu après avoir parlé de la musique de SPK sur l'album Zamia Lehmanni avec un ami. Graeme Revell a quitté SPK après cet album sublime et a commencé à réaliser de la musique de film pour Hollywood. C'est d'autant plus surprenant pour ce néo-zélandais qui pratiquait un indus extrême et radical de le voir se plier aux canons hollywoodiens. Mais il y a réussi et est devenu un compositeur prolixe et respecté. Deux vies en une. Bref, Calme Blanc est l'une de ses premières compos pour le cinéma (sa première ?) et ce qui est intéressant, c'est que le score, très réussi, utilise un thème de Zamia Lehmanni ce que ne manquaient pas de noter les fans d'indus à la sortie du film. A part ça, j'ai toujours adoré ce film, je le connais par coeur, c'est un thriller domestique maritime en forme de huis clos à 3 personnages, super tendu et hyper bien mis en scène (Noyce n'a jamais fait mieux). A revoir aujourd'hui on voit bien quelques tics des 90's un peu clichés et désagréables, mais ça ne gâche en rien le plaisir total de ce parfait divertissement du dimanche soir.

Jeremy-Paul Kagan est l'un des secrets les mieux gardés d'Hollywood. De lui je n'avais vu jusqu'à présent que The Big Fix, film extraordinaire, sorte de relecture débonnaire et très libre du Privé de Robert Altman, dans lequel Richard Dreyfuss trouvait peut-être son plus beau rôle. Surtout, la mise en scène du film est signe d'un très grand. Fou de joie donc, quand j'ai vu que ce Héros sortait en bluray. Héros est le premier film de Kagan, il était jusqu'à présent réalisateur pour la TV, officiait dans diverses séries, et c'est fou de constater que dès son premier film il réalise un chef-d'oeuvre. Casting de rêve, déjà : Henry Winckler, alias Fonzy, qu'il est précieux de voir dans un vrai film avec un vrai rôle, et de constater qu'il est un acteur merveilleux, plein d'humour et de nuances même dans la tragédie, une sorte de Dustin Hoffmann bis. Sally Field ensuite, une des plus grandes, aussi émouvante que dans sa trilogie avec Martin Ritt, c'est dire. Et le jeune Harrison Ford, en éleveur de lapins, vient compléter le trio. Je sais que je vais attirer l'attention en signifiant que c'est l'un des plus grands films méconnus du Nouvel Hollywood, et surtout que c'est, je crois, le premier film sorti concernant la Guerre du Vietnam et ses conséquences désastreuses (la sortie française est 1979 mais le film est de 1977). Oui, avant Coppola, avant Cimino, avant Hal Ashby (Héros fait beaucoup penser à Coming Home d'ailleurs, les films ont pas mal de points communs), avant tout le monde, on peut même dire que c'est Héros de Kagan qui a lancé cette grande vague de films sur le Vietnam, qui compte parmi les plus beaux films de cette époque. Celui-ci est vraiment de cette trempe, je ne vous en raconte pas l'histoire si attachante, mais disons qu'il s'agit d'un road movie très attachant, parfois très drôle, mais qui parle des conséquences traumatiques de la Guerre du Vietnam sur un jeune homme marqué à vie parce qu'il a vécu. C'est bouleversant, mis en scène avec une intelligence et une aisance rares, et comme beaucoup de grands films, ça croise les genres pour aller de la comédie au drame, du road movie au mélodrame, bref, c'est à découvrir d'urgence, comme le reste de l'oeuvre de ce grand cinéaste méconnu.
I like your hair.
- groil_groil
- Messages : 3793
- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12
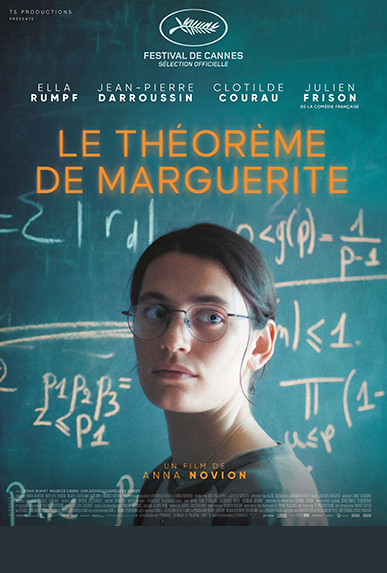
Une jeune mathématicienne brillante et juste ce qu'il faut d'autiste perd pied en tentant par tous les moyens de résoudre la conjecture de Goldbach, assertion mathématique qui est le sujet de sa thèse. C'est un chouette film, dont la réalisatrice est aussi la compagne de Darroussin, présent dans le film, ayant réalisé notamment quelques épisodes du Bureau des Légendes. Le film est pas mal du tout, en tout cas intègre, j'aime ces trajectoires personnelles qui peuvent aller jusqu'à la folie pour prouver quelque chose, mais il y a tout de même un vrai problème de mise en scène qui laisse le spectateur à l'écart, sur le côté. J'essaie de m'expliquer. Le film n'est composé quasiment de deux trucs (j'exagère) : des théorèmes de math sur des tableaux, et la jeune femme qui joue au Mahjong (après avoir abandonné son poste, et comme elle vit dans un quartier chinois, elle apprend vite le mahjong en l'analysant via des théorèmes mathématiques, gagne à chaque coup, et va gagner de l'argent dans les tripots en affrontant de vieux experts chinois et en les battant). Or, dans les deux cas, parties de mahjong comme théorème de math, la cinéaste nous laisse à l'écart et ne parvient jamais à nous expliquer les enjeux de base de ce qu'elle filme. Elle plagie le cinéma américain, mais le cinéma américain sait faire ça, nous impliquer, ou tout au moins nous donner l'illusion, par la mise en scène, que nous comprenons des choses compliquées. Je pense par exemple à Queens Gambit où vous vous passionnez pour les échecs même si vous ne savez pas y jouer, ou bien à Un Homme d'exception, excellent film de Ron Howard où les mathématiques économiques sont montrées avec précision mais où tout est passionnant car la mise en scène englobe le spectateur dans sa réflexion. Il y a des centaines d'exemples comme ça, je me contente de ces deux là. Le souci c'est que Novion n'arrive jamais à cela, et que même bien souvent elle n'essaie pas. Elle peut même laisser le jeu de mahjong hors champ pour se concentrer sur le visage de son héroïne, incapable de traduire par sa mise en scène la complexité de ce qu'elle est en train de réaliser. C'est dommage car le film aurait pu être vraiment captivant, mais il pêche par défaut de mise en scène. On parvient parfois à s'ennuyer quand il se passe quelque chose de captivant à l'écran, on voit la jeune femme folle de joie de résoudre son théorème sans éprouver sa joie, c'est tout de même problématique. Sinon, la jeune actrice Ella Rumpf a gagné le César de la Meilleure Révélation Féminine avec ce rôle, ce n'est pas volé, elle est très bien (même si Kim Higelin dans Le Consentement l'aurait mérité à mon avis), mais son rôle n'est pas ouf non plus, un peu là aussi à l'américaine en moins bien, tendance la bonnasse à qui on attache les cheveux et on met des grosses lunettes pour faire croire que c'est un boudin autiste... Mouaif, on attendait mieux de la part d'un regard de femme cinéaste...
I like your hair.
- groil_groil
- Messages : 3793
- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Fan de Jack Arnold et du cinéma fantastique fauché des 50's, je n'avais pourtant jamais vu un des hits des deux catégories, la mythique Etrange Créature du Lac Noir. Je ne suis pas déçu, le film est à la hauteur de mes attentes, et bien évidemment, même si on voit le côté cheap (un mec engoncé tant bien que mal dans un déguisement de monstre aquatique), le film est merveille de poésie, d'horreur et de mise en scène. C'est dingue de voir comment un film pareil nourrira les imaginaires des cinéastes et des spectateurs à venir sur des dizaines d'années, un peu, dans un registre différent mais tant que ça, comme les Frankenstein de James Whale des années 30. Une anecdote que j'aime beaucoup, concernant Guillermo Del Toro (un des plus grands cinéphiles, et cinéphiles bis qui existe) et son film La Forme de l'Eau. D'ailleurs je n'aimais pas trop ce film à sa sortie mais plus j'y repense plus je pense à ses qualités, et je le reverrai sans doute. Bref, ce n'est pas le sujet : Del Toro disait dans une interview que la seule motivation qui l'avait poussé à réaliser La Forme de l'Eau était de tenter de revivre l'émotion érotique qu'il avait ressentie enfant à la découverte de l'Etrange Créature du Lac Noir, au moment où la naïade (sublime Julia Adams qui est pour moi une grosse révélation, je vais creuser sa filmo, quelle beauté !) part se baigner et que le monstre est au fond de l'eau, s'approche d'elle, mais ne la dévore pas, tombe sous son charme, essaie de la toucher délicatement et qu'ils réalisent ensemble (sans qu'elle le sache) un sublime ballet aquatique. Je trouve ça absolument sublime, je ne connais pas grand chose de plus beau au cinéma, qu'un homme décide de réaliser un film entier (des ans de travail, des centaines de salariés, des dizaines de millions de dollars de budget) uniquement pour faire revivre un souvenir d'enfance. Mais en effet, lorsque l'on découvre ce qui a déclenché ce fantasme, c'est facile à comprendre.
I like your hair.
- groil_groil
- Messages : 3793
- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12

Au milieu du 19ème siècle, à Bologne, un jeune enfant d'une famille nombreuse juive est enlevé à ses parents par la Saine Inquisition Catholique, au prétexte qu'il aurait été baptisé (de fait, par une servante un peu idiote qui voulait sauver son âme et qui l'a fait elle-même avec un peu d'eau avant de s'en ouvrir au curé du coin), et qu'il se doit de suivre une éducation catholique. Je vous laisse imaginer le trauma chez les parents qui vont tout faire, mais malheureusement en vain, pour tenter de récupérer leur gosse... Sacré et infatigable Marco Bellocchio qui à 84 balais continue de sortir a minima un film par an et qui propose des chefs-d'oeuvre de ce calibre, à un âge où les cinéastes sont bien souvent sénile (je fais abstraction de Manoel de Oliveira qui fut tellement hors norme sur la question). Car L'Enlèvement est bel et bien un chef-d'oeuvre, un film dans lequel Bellocchio règle ses comptes avec la religion catholique et avec (c'est une pure supposition) une éducation qu'il a sans doute reçue de force et qui a dû laisser des traces... Le film est d'une noirceur et d'une cruauté sans nom, c'est si terrible que c'est souvent difficile de s'y confronter, d'autant que le cinéaste termine son oeuvre de la manière la plus terrible qui soit, en faisant gagner la religion catholique : le gamin devenu adulte se considère vraiment comme catholique, il y consacrera sa vie jusqu'à ses 90 ans, il n'ira pas à l'enterrement de son père et tentera de convertir sa mère au catholicisme sur son lit de mort. Le cinéma de la cruauté disait Bazin... en voici un parfait et merveilleux exemple.
I like your hair.

Plus souvent référé à Bunuel, Dupieux s'attaque ici à une autre icône du surréalisme, l'inénarrable Dali. N'aimant ni son travail ni sa personnalité médiatique,j'ai fait preuve de méfiance lorsque fut annoncé le film. Fort heureusement, Dupieux est loin du panégyrique, n'hésitant pas à tailler un costume sur mesure à l'artiste.
Je dois avouer avoir beaucoup ris et être tout à fait sensible à l'absurde jusqu'au boutisme caractérisant le film. Néanmoins l'ensemble reste bien sage et calibré, Dupieux donnant l'impression de rester tout du long dans sa zone de confort, à deux doigts de recycler son propre style, blagues et formules pouvant s'étendre à l'infini. Lui reste, comme toujours, un sens visuel et esthétique épatant qui porte tout à fait le film. Espérons que Dupieux finisse par se secouer un peu plus dans ses prochaines réalisation, sinon nous serons à deux doigts d'un syndrome JP Mocky, version contemporaine (très petit budget, acteurs célèbres car il "faut avoir joué pour ce réalisateur" etc...)

Fraichement sorti de 15 ans de prison, Fred retourne dans sa communauté gitane pour renouer avec les siens, mais les choses ont changés. Bien décidé à se "mettre au chaud" il décide immédiatement de mener un braquage, embarquant avec lui ses deux demi-frères pourtant réticents.
Le film démarre sur un schéma scénaristique classique (sortie de prison/casse), enrobé d'un style proche du documentaire. Alors que l'approche quasi voyeuriste tourné vers la communauté gitane pose question, les doutes se diluent peu à peu lorsque commence l’errance et les déboires des trois héros. Le point de bascule se fait lors du braquage -raté-, aux images soudainement hyper stylisées, faites d'éclats vifs et de teintes colorimétriques dévorantes. Plus qu'un coup d'éclat de mise en scène, ces choix se prolongent durant la longue fuite nocturne des personnages, faisant tendre le film vers une abstraction en clair obscur dans lequel les corps des personnages ne sont plus que des points filants dans la nuit, entourés de lueurs blafardes et hallucinogène. Le film embrasse alors totalement des questions de filiation, d'histoire intime et communautaire, de transmission, de sacrifice et de noeuds qui se rejouent, sous un éclairage quasi-mystique, que l'on ne sentait jusqu'à présent qu'en lointain sous-texte. Belle surprise.

La maison dans l'ombre - Nicholas Ray - 1951
Un flic solitaire et excessif se faire mettre au vert par sa direction, envoyé "upstate" pour enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Le film est construit sur deux parties que tout semble opposer, jusqu'à la colorimétrie des images : de la ville nocturne et glauque nous passons à la campagne enneigée. Le point d'équilibre centripète, errant, n'étant autre que la solitude du personnage principal. A la campagne il se confronte à "plus fort que lui", le conduisant à reconsidérer sa propre existence et mentalité : un campagnard excessivement bourru mais surtout une belle jeune femme aveugle et isolée, dépendante de son frère pour vivre, frère qui se révélera rapidement être le meurtrier présumé. Le point d'orgue du film se trouve dans l'aboutissement d'une course poursuite entre le flic et le jeune homme. Après avoir quitté la ville, puis le village, puis la maison isolée, après une courses de corps sur des étendues blanches, ils se retrouvent dans un minuscule cabanon investit par le jeune homme, ou il s'est recrée un espace intime et miniature, peuplé d'objet et de petits jouets. Ce point, presque hors du monde mais contenant un monde intime, semble le symbole même du film, qui ne cesse de nous parler de la difficulté d'être, de la rudesse des rapports sociaux et humains, de la solitude construite et subie, et de la fragilité entre l'inadaptation et la dépendance. A ce titre, les plans finaux (retour du flic vers la campagne et l'amour) semblent peu raccord avec la rudesse d'ensemble du film : il se trouvent qu'ils ont été tournés et rajoutés contre le gré de Ray. Un point qui ne surprendra pas les connaisseurs de son travail, souvent porté par une douleur sourde et mélancolique.
Brody a vu juste
http://nyer.cm/rEVGvJ4?fbclid=IwAR0SMH6 ... M6fRErSIOg
http://nyer.cm/rEVGvJ4?fbclid=IwAR0SMH6 ... M6fRErSIOg
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
@cyborg
Je regardai la programmation du CLaP et je vois qu'ils programment The human surge 3 en présence d'Eduardo Williams (mais de mémoire tu n'es pas parisien - moi non plus d'ailleurs ).
).
Mais surtout, apparemment le film est distribué par Norte pour une sortie salle en mai.
On aura beau dire ce qu'on veut sur la qualité des sorties, il y a toujours des distributeurs kamikazes qui sont prêts a tout !
Je regardai la programmation du CLaP et je vois qu'ils programment The human surge 3 en présence d'Eduardo Williams (mais de mémoire tu n'es pas parisien - moi non plus d'ailleurs
Mais surtout, apparemment le film est distribué par Norte pour une sortie salle en mai.
On aura beau dire ce qu'on veut sur la qualité des sorties, il y a toujours des distributeurs kamikazes qui sont prêts a tout !
- Tamponn Destartinn
- Messages : 1140
- Enregistré le : ven. 9 oct. 2020 21:11

Film exceptionnel sur ses 2 premiers segments, montrant la décadence innée des USA et les conséquences sur les natifs américains. On commence par un western à l'ambiance assez inédite, je n'avais pas ressenti cela depuis Dead Man de Jarmusch (un de mes films préférés ever). Puis l'arrivée du contemporain est un coup de massue étrange : le monde n'a pas si évolué que cela...
Malheureusement, le film a une 3ème partie pas à du tout à la hauteur du reste. Je comprends la logique (même sujet, mais en passant à l'échelle mondiale), mais dans les faits c'est moins bien. On dirait du sous Apichatpong Weerasethakul, là où les 2 autres segments ne ressemblent à rien d'autres qu'eux même.
Franchement, le film aurait été parfait en terminant sur la dernière image de la partie 2. Et il aurait duré environ 1h50 au lieu de 2h40 aussi, c'est dommage !
Mais j'ai vu qu'il y avait des défenseurs de cette 3e partie. Je peux comprendre. Elle n'est pas non plus honteuse. Et quoiqu'il en soit, c'est un des grands films de ce début d'année, aucun doute là dessus.
@yhi : en effet je ne suis pas parisien, mais m'y rend tout de même régulièrement. Pas à la date de ce festival malheueusement et je viens de voir que j'ai raté une projo du film à Bruxelles en février, où j'habite ! Mais si qqn à la bonne idée de le sortir en salle, peut-être aurais-je d'autres chances !
Quant à moi, récemment :
Je ne suis à priori pas très Ruizien, et pourtant, 3 à la suite :

Les divisions de la nature - Raul Ruiz - 1981
Documentaire de 30 minutes sur le château de Chambord, à travers différents prismes : l'esprit de son époque ayant conduit à cette construction hors-norme, des traités de philosophies et d'architectures, ses habitants d'alors, son utilisation contemporaine... Prisme est le mot juste car des effets de reflets et de déformations de l'image se multiplient progressivement, rendant la construction plus folle qu'elle ne l'est encore, plus surréel, ou plutôt plus irréel qu'elle ne l'a toujours été, jusqu'à la faire complètement fondre. Le résultat est à la fois rigoureux, original et convaincant. Peut-être la meilleure chose que j'ai vu de Ruiz. Le format télévisuel (une commande d'Antenne 2 je crois ?) lui convenait-il bien ?
Dispo en qualité très correcte sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=P5BNmpr ... annel=Adit

Le territoire - Raul Ruiz - 1981

Mis en jambe par la bonne surprise de Les Divisions de la Nature, paru la même année avec le même chef op, je me suis laissé tenter par Le Territoire.
Un groupe d'amis (?) se retrouve dans un gite de montagne pour partir quelques jours en randonnée. Mais très vite les choses dégénèrent, le guide s'enfuit et les personnages errent alors sans but jusqu'à se déchirer totalement.
Il y a quelque chose de très Borgessien dans ce territoire qui semble s’agrandir au fil de la marche tout en s'enroulant sur lui-même, faisant revenir constamment les personnages en son centre/son point de départ. Mais Ruiz n'en fait quasiment rien, la folie naissante semble ridicule, tout comme les interactions et actions de personnages, devenant du plus en plus méchants et sadiques. Quant à la conclusion, elle est aussi prétentieuse que ridicule et inintéressante à un point inimaginable. Même les effets de déformations de l'image, et de colorisation, bien que très beau, tombent à plat car utilisés sans subtilité.
Si le film semble très prisonnier de son époque (le début des 80s étant encore très les 70s, version violent bad-trip post hippy), il réunit surtout tout ce que je déteste chez Ruiz, qui ne peut s’empêcher la pose arty prétentieuse et un goût trop prononcé pour le mystérieux frelaté.

Le voyage d'une main - Raul Ruiz - 1984
Tentative de relecture post-moderne des "Statues meurent aussi", mélangé à des idées post-coloniales et des narrations chimériques. Du moins j'imagine ? A mon sens, le résultat est une fois encore catastrophique.
Quant à moi, récemment :
Je ne suis à priori pas très Ruizien, et pourtant, 3 à la suite :

Les divisions de la nature - Raul Ruiz - 1981
Documentaire de 30 minutes sur le château de Chambord, à travers différents prismes : l'esprit de son époque ayant conduit à cette construction hors-norme, des traités de philosophies et d'architectures, ses habitants d'alors, son utilisation contemporaine... Prisme est le mot juste car des effets de reflets et de déformations de l'image se multiplient progressivement, rendant la construction plus folle qu'elle ne l'est encore, plus surréel, ou plutôt plus irréel qu'elle ne l'a toujours été, jusqu'à la faire complètement fondre. Le résultat est à la fois rigoureux, original et convaincant. Peut-être la meilleure chose que j'ai vu de Ruiz. Le format télévisuel (une commande d'Antenne 2 je crois ?) lui convenait-il bien ?
Dispo en qualité très correcte sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=P5BNmpr ... annel=Adit

Le territoire - Raul Ruiz - 1981

Mis en jambe par la bonne surprise de Les Divisions de la Nature, paru la même année avec le même chef op, je me suis laissé tenter par Le Territoire.
Un groupe d'amis (?) se retrouve dans un gite de montagne pour partir quelques jours en randonnée. Mais très vite les choses dégénèrent, le guide s'enfuit et les personnages errent alors sans but jusqu'à se déchirer totalement.
Il y a quelque chose de très Borgessien dans ce territoire qui semble s’agrandir au fil de la marche tout en s'enroulant sur lui-même, faisant revenir constamment les personnages en son centre/son point de départ. Mais Ruiz n'en fait quasiment rien, la folie naissante semble ridicule, tout comme les interactions et actions de personnages, devenant du plus en plus méchants et sadiques. Quant à la conclusion, elle est aussi prétentieuse que ridicule et inintéressante à un point inimaginable. Même les effets de déformations de l'image, et de colorisation, bien que très beau, tombent à plat car utilisés sans subtilité.
Si le film semble très prisonnier de son époque (le début des 80s étant encore très les 70s, version violent bad-trip post hippy), il réunit surtout tout ce que je déteste chez Ruiz, qui ne peut s’empêcher la pose arty prétentieuse et un goût trop prononcé pour le mystérieux frelaté.

Le voyage d'une main - Raul Ruiz - 1984
Tentative de relecture post-moderne des "Statues meurent aussi", mélangé à des idées post-coloniales et des narrations chimériques. Du moins j'imagine ? A mon sens, le résultat est une fois encore catastrophique.
Modifié en dernier par cyborg le sam. 16 mars 2024 13:42, modifié 1 fois.

Binnu Ka Sapna - Kanu Behl - 2018
Court métrage indien nous plaçant dans la peau d'un jeune homme tombant peu à peu dans la misogynie et la masculinité toxique. "Pourquoi pas ?", mais le résultat manque de mise en perspective ou de point de mise en scène permettant la remise en cause de ce qui est montré. J'ai du aller vérifier en ligne après le film les intentions du réalisateur pour bien être certain de son propos... Le visionnage est donc assez malaisant et la forme pas particulièrement convaincante, malheureusement.

Troisième film de Tanaka et deuxième que je visionne et n'y allons pas par quatre chemin : c'est un chef d’œuvre.
Mes petites réserves émise au sujet de La lune s'est levé concernaient, je crois, avant tout ce que le film avait "d'Ozuesque", et pour cause : Ozu en était le scénariste. D'ailleurs plus j'explore le cinéma japonais, plus il m'apparait évident qu'Ozu ne mérite pas la place de parangon qui lui fut construite par une histoire traditionnelle du cinéma, assurément lié à une époque mais également basé sur une certaine vision, empreinte de conservatisme, que l'on voulait avoir de l'Asie.
Bref, Maternité Eternelle est scénarisé par une femme (Sumie Tanaka - famille différente, malgré le nom similaire) et c'était assurément la meilleure chose à faire. Rarement nous aurons vu à l'écran la question de la féminité traité avec autant de complexité et de délicatesse, de grandeur et de pudeur. Tout l'enjeu du film est annoncé au détour d'une répartie, lors de la première séance de lecture de poésie et qu'un homme commente en riant (accompagné de tout le groupe) le texte de l'héroïne : "c'est le point de vue d'une femme !". Ces rires supposément anodin, mais intolérants et castrateurs, raisonneront longtemps aux oreilles des spectateurs. De la perte de ses enfants à celle de sa poitrine, la poétesse semble se détacher de toutes les conventions sociales imposés aux femmes. Préférant se consacrer à sa pratique de l'écriture (dur de ne pas faire le parallèle avec Tanaka elle même) elle met à mal les attentes, se créant un espace de liberté telle qu'elle le peut. Et quand elle rencontre quelqu'un l'aimant pour ce qu'elle est vraiment (sa poésie, et donc son esprit), il est malheureusement trop tard : difficile de ne pas être déchiré par ce final hautement tragique.
La mise en scène quant à elle est d'une inventivité et d'une précision superbe. Une fois encore, sa gestion de l'espace et ses mouvements d'appareils (souvent "vers l'avent") s'inscrivent en faux avec la statique "hauteur de tatami" d'Ozu. Car si tristesses et peines sont ici infinies, l'énergie et l'espoir le sont tout autant.
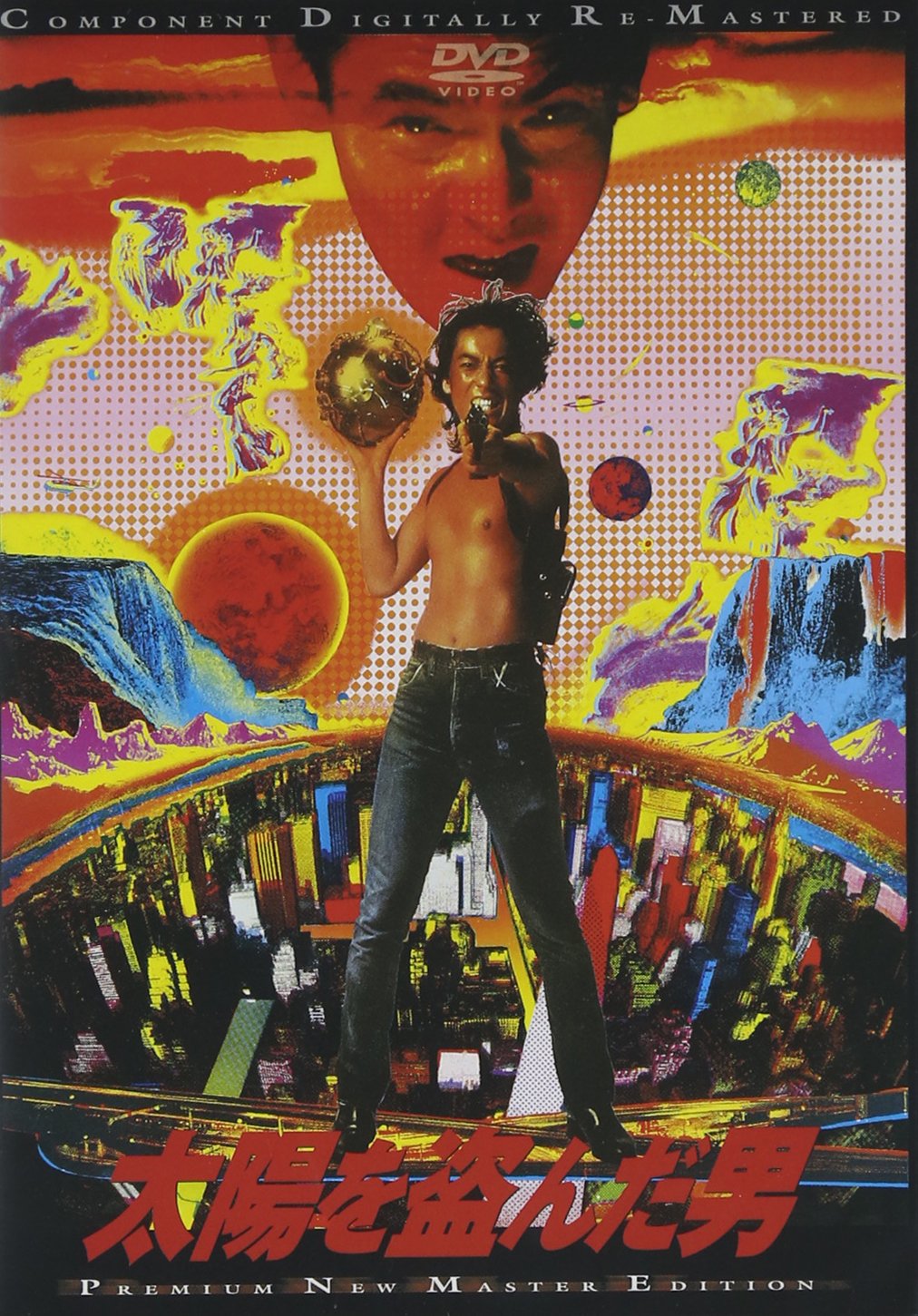
The man who stole the sun - Kazuhiko Hasegawa - 1979
Sous ce titre intriguant se cache un film loufoque et hors-norme : un professeur de physique au lycée décide de construire sa propre bombe atomique. Ne sachant quoi en faire il s'en sert pour exiger des choses absurdes au gouvernement, devenant de la même terroriste solitaire. Du "seul contre tous" le film glisse progressivement vers le "un contre un", l'oeuvre se concluant sur une longue course poursuite entre le héros et un flic dur à cuire.
Éreintant (2h40 c'est vraiment trop) mais ébouriffant, L'homme qui a volé... adopte un ton volontairement grotesque (souvent très drôle), qui n'est pas absent d'un regard sur son époque et la jeune génération d'alors, perdu entre nihilisme et socialisme, bouleversé par l'imaginaire post-nagazaki et l'activisme politique.
Série B qui à tout d'une série A, série A qui a tout d'une série B, le film convainc avant tout car, de sa démesure à sa drôlerie, de sa grandeur à sa bouffonnerie il ne ressemble à rien d'autre qu'à lui même et il le fait très bien !
Comme j’ai du retard avec les films :
Une question : comment se fait-il que personne n’a vu “Les carnets de Siegfried” ? Les Cahiers le défend beaucoup mais perso, je suis hyper réticent car j’avais littéralement détesté “Of Time and city”, un pas tres ancien film de Terence Davies
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
Il est tristement non diffusé chez moi. J'espère pouvoir le rattraper en ligne d'ici la fin de l'année.
Je n'avais pas trop aimé ses derniers films (The deep blue sea & Emily Dickinson) mais l'an dernier j'avais decouvert Une longue journée qui s'achève et c'était magnifique alors je suis quand même curieux.
Je n'avais pas trop aimé ses derniers films (The deep blue sea & Emily Dickinson) mais l'an dernier j'avais decouvert Une longue journée qui s'achève et c'était magnifique alors je suis quand même curieux.
Merci de ta réponse !!!yhi a écrit : ↑lun. 18 mars 2024 18:22Il est tristement non diffusé chez moi. J'espère pouvoir le rattraper en ligne d'ici la fin de l'année.
Je n'avais pas trop aimé ses derniers films (The deep blue sea & Emily Dickinson) mais l'an dernier j'avais decouvert Une longue journée qui s'achève et c'était magnifique alors je suis quand même curieux.
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
- Tamponn Destartinn
- Messages : 1140
- Enregistré le : ven. 9 oct. 2020 21:11

C'est mieux que le premier, je dirai même "bien mieux" d'après mes souvenirs brumeux du 1, mais j'en ai quand même pas mal rien à foutre !
La quasi totalité des personnages nous sont montrés avec une distance froide. Certains n'étant caractérisés que par une idée qui ne bouge jamais. D'autres subissant une évolution au contraire énorme, mais ne compte pas sur Villeneuve pour te le faire vivre ou ressentir avec eux, juste tu le constates au loin. Et je suis désolé, ça ne marche pas dans le cadre d'un blockbuster de 3h. Si Villeneuve veut être un plasticien, qu'il ne fasse pas de franchise hollywoodienne aussi chère. Parce qu'en plus, c'est un mec que je défends plutôt, d'habitude. Mais là, je le trouve pris dans un engrenage de l'enfer, quasi à la Cameroun avec Avatar. Enfin, dans les cas, ils semblent prendre leur pied, donc tant mieux pour eux, mais ce n'est pas mon délire.
Vosg'patt de cœur
- Tamponn Destartinn
- Messages : 1140
- Enregistré le : ven. 9 oct. 2020 21:11
oula
non, y a pas de jeu de mot ou quoi, je me suis pas relu comme d'habitude, faut vraiment que j'arrête de faire ça
non, y a pas de jeu de mot ou quoi, je me suis pas relu comme d'habitude, faut vraiment que j'arrête de faire ça

Et bien moi, au contraire, j'ai marché (déjà pour le premier, j'avais pas boudé mon plaisir). En étant conscient des scories Malickiennes/Nolannienes dorénavant courantes dans ce genre de superproductions, ces quelques visions éthérées vaguement publicitaires qui appauvrissent le potentiel psychédélique qu'il y avait dans le roman (né de la contre-culture américaine, rappelons le). Mais au delà de ça, et de la richesse interprétative du récit, je trouve qu'il y a de la matière dans ce film. C'est vivant, parce que palpable, un grand soin est apporté à la matière, à lumière, des qualités assez rares dans le cinéma grand public américain. Et puis, un film sans second degré qui prend au sérieux son univers et ce qu'il raconte, c'est assez rare être souligné également. Ce n'est pas tellement le cinéma que j'ai envie de défendre habituellement, mais il y a quelque chose de vraiment humble et sincère dans l'entreprise.
Dersou Ouzala - Akira Kurosawa

Immense plaisir à le revoir dans de bonnes conditions et surtout de l'apprécier encore plus avec le recul sur la carrière du maître que j'ai maintenant. Déjà c'est fou comment ce film tranche avec les films en N&B plus traditionnels de son auteur (au delà d'être un pur produit de Mosfilm, avec la pellicule 70's), on sent jusque dans les expressions et les plans fixes que quelque chose a changé dans le regard et la mise en scène. C'est un film de patience, calme et sage presque on pourrait dire. Je me souvenais de superbes paysages mais le film est bien plus que ça. Oui, les transitions entre les saisons sont superbes (et les feuilles d'automne particulièrement sont très chatoyantes sur cette pellicule), oui landes gelées de la taïga sont sublimes et il y a des passages de pure graphisme (comme sur ces flots de banquise qui viennent s'échouer ou ce soleil rouge) qui valent le coup d'œil mais ce film est avant tut une histoire d'amitié superbe, chose que j'avais un peu moins vue/retenue à l'époque et qui m'a aujourd'hui, sans vraiment m'en rendre compte tout à fait, arraché de sacrées larmes. Plus que d'amitié, ça serait un grand film sur la fraternité à travers les frontières et les domaines, et de la force de ce lien indéfectible (plan final magistral sur un bâton planté dans la neige - rester vertical jusqu'au bout) qui fut brisée par la peur, par les normes sociales et bientôt la cupidité. J'avais aussi oublié cette courte mais superbe partie du film en ville où le capitaine Andreiev invite Dersou chez lui avec sa femme et son gosse. Le petit est fasciné par les histoires du chasseur, il y a une scène magnifique où les parents regardent en secret leurs interactions. Plus tard, on ressent tout l'ennui et la détresse du personnage de Dersou (nom qui résonne toujours dans ma tête avec autant de tristesse) d'être flanqué à ne rien faire, coincé dans un boîte, devant la cheminée, sans air... C'est bête mais terrifiant.
Et puis que dire de cette scène où un tigre vient rôder autour de Dersou, sa robe se confondant presque avec les feuilles dorées des arbres. Les couleurs sur ce genre de films c'était quelque chose mine de rien. Tiens ça me redonne envie de remater ce tout aussi superbe film qu'était Godland....
Seul problème : le son qui est assez mauvais et agressif dans ses transi entre les pistes audio que l'on sent vraiment (mais j'imagine qu'ils n'ont pas pu tout restaurer).

Immense plaisir à le revoir dans de bonnes conditions et surtout de l'apprécier encore plus avec le recul sur la carrière du maître que j'ai maintenant. Déjà c'est fou comment ce film tranche avec les films en N&B plus traditionnels de son auteur (au delà d'être un pur produit de Mosfilm, avec la pellicule 70's), on sent jusque dans les expressions et les plans fixes que quelque chose a changé dans le regard et la mise en scène. C'est un film de patience, calme et sage presque on pourrait dire. Je me souvenais de superbes paysages mais le film est bien plus que ça. Oui, les transitions entre les saisons sont superbes (et les feuilles d'automne particulièrement sont très chatoyantes sur cette pellicule), oui landes gelées de la taïga sont sublimes et il y a des passages de pure graphisme (comme sur ces flots de banquise qui viennent s'échouer ou ce soleil rouge) qui valent le coup d'œil mais ce film est avant tut une histoire d'amitié superbe, chose que j'avais un peu moins vue/retenue à l'époque et qui m'a aujourd'hui, sans vraiment m'en rendre compte tout à fait, arraché de sacrées larmes. Plus que d'amitié, ça serait un grand film sur la fraternité à travers les frontières et les domaines, et de la force de ce lien indéfectible (plan final magistral sur un bâton planté dans la neige - rester vertical jusqu'au bout) qui fut brisée par la peur, par les normes sociales et bientôt la cupidité. J'avais aussi oublié cette courte mais superbe partie du film en ville où le capitaine Andreiev invite Dersou chez lui avec sa femme et son gosse. Le petit est fasciné par les histoires du chasseur, il y a une scène magnifique où les parents regardent en secret leurs interactions. Plus tard, on ressent tout l'ennui et la détresse du personnage de Dersou (nom qui résonne toujours dans ma tête avec autant de tristesse) d'être flanqué à ne rien faire, coincé dans un boîte, devant la cheminée, sans air... C'est bête mais terrifiant.
Et puis que dire de cette scène où un tigre vient rôder autour de Dersou, sa robe se confondant presque avec les feuilles dorées des arbres. Les couleurs sur ce genre de films c'était quelque chose mine de rien. Tiens ça me redonne envie de remater ce tout aussi superbe film qu'était Godland....
Seul problème : le son qui est assez mauvais et agressif dans ses transi entre les pistes audio que l'on sent vraiment (mais j'imagine qu'ils n'ont pas pu tout restaurer).

Je sais bien que tu es méga fan de ce film mais je ne vois pas ce qu'on peut trouver cinématographiquement intéressant dans "Le nom de la rose"
Modifié en dernier par sokol le jeu. 21 mars 2024 16:23, modifié 1 fois.
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
Dune deuxième partie de Denis Villeneuve
Il y a les mêmes problèmes que dans la première partie, entre les acteurs mal dirigés, les dialogues creux et l'étalonnage en dents de scie. Mais contrairement au premier film qui était très cloisonné que ce soit dans ses espaces naturels et son scénario, je retrouve ici ce qui me plaît chez Villeneuve : la perspective. C'est probablement encore un des rares à savoir insuffler de l'ampleur dans des films à grand spectacle. Même Cameron et Nolan n'y arrivent plus. Il suffit de prendre la scène avec Paul Atréides enfourchant un gros ver (sans malentendu), le petit face au grand, l'intensité est là parce que Villeneuve ne se contente pas de taper du coude en rigolant. Il met en scène en utilisant pleinement l'espace. Cela reste simple dans sa composition : le groupe, le dieu, la nature et le solitaire, et en même temps très élaboré dans son aspect technique. Il y a également la musique, celle bien reconnaissable de Zimmer que j'aime pour ce genre de films. J'étais moins convaincu pour la première partie mais ici elle emporte par son souffle épique, quand bien même cela se répète et fait beaucoup boum boum (on reste quand même dans un gros divertissement genre parc d'attractions à Disneyland, donc normal que ça fasse du bruit). Ce qui reste le plus dommageable, c'est la caractérisation des personnages, ce n'est pas ce qu'il y a de pire mais c'est loin de susciter l'émotion. Chacun joue un rôle délimité, comme si on avait juste dit aux acteurs : toi tu joues le messie, toi le psychopathe, toi le fanatique, toi la femme guerrière opposée aux fanatiques... On peut faire une belle équipe de foot avec ça mais c'est plus difficile à admettre dans un film adapté d'un livre où les personnages étaient quand même mieux développés. Heureusement qu'il y a de brefs accès de maladresse, venant souvent de Zendaya, pour donner un peu de respiration à une équipe d'acteurs qui connaissent en effet bien leur métier mais rivalisent de constipation.
Il y a les mêmes problèmes que dans la première partie, entre les acteurs mal dirigés, les dialogues creux et l'étalonnage en dents de scie. Mais contrairement au premier film qui était très cloisonné que ce soit dans ses espaces naturels et son scénario, je retrouve ici ce qui me plaît chez Villeneuve : la perspective. C'est probablement encore un des rares à savoir insuffler de l'ampleur dans des films à grand spectacle. Même Cameron et Nolan n'y arrivent plus. Il suffit de prendre la scène avec Paul Atréides enfourchant un gros ver (sans malentendu), le petit face au grand, l'intensité est là parce que Villeneuve ne se contente pas de taper du coude en rigolant. Il met en scène en utilisant pleinement l'espace. Cela reste simple dans sa composition : le groupe, le dieu, la nature et le solitaire, et en même temps très élaboré dans son aspect technique. Il y a également la musique, celle bien reconnaissable de Zimmer que j'aime pour ce genre de films. J'étais moins convaincu pour la première partie mais ici elle emporte par son souffle épique, quand bien même cela se répète et fait beaucoup boum boum (on reste quand même dans un gros divertissement genre parc d'attractions à Disneyland, donc normal que ça fasse du bruit). Ce qui reste le plus dommageable, c'est la caractérisation des personnages, ce n'est pas ce qu'il y a de pire mais c'est loin de susciter l'émotion. Chacun joue un rôle délimité, comme si on avait juste dit aux acteurs : toi tu joues le messie, toi le psychopathe, toi le fanatique, toi la femme guerrière opposée aux fanatiques... On peut faire une belle équipe de foot avec ça mais c'est plus difficile à admettre dans un film adapté d'un livre où les personnages étaient quand même mieux développés. Heureusement qu'il y a de brefs accès de maladresse, venant souvent de Zendaya, pour donner un peu de respiration à une équipe d'acteurs qui connaissent en effet bien leur métier mais rivalisent de constipation.
- Tamponn Destartinn
- Messages : 1140
- Enregistré le : ven. 9 oct. 2020 21:11

C'est très rigolo, bien foutu, malin.
C'est aussi assez programmatique et cousu de fil blanc, pour être honnête.
Mais qu'importe, je n'ai pas boudé mon plaisir.
Bourgoin joue toujours pareil, mais elle marche très bien dans le rôle. Pareil pour Lacaille. Le côté comédie romantique n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais leur duo fonctionne à fond. Quant aux ados, très bon casting.
- groil_groil
- Messages : 3793
- Enregistré le : jeu. 8 oct. 2020 21:12
Ecoute je ne sais pas quoi te répondre Sokol, oui c'est du cinéma grand public, mais j'adore le roman d'origine, j'adore la trame générale, l'ambiance, et j'adore ce qu'en a fait Annaud, disons que c'est impossible de retranscrire la densité du livre de plus de mille pages érudites en un film, mais je ne vois pas comment on peut s'en tirer mieux qu'Annaud. Alors la mise en scène oui, elle est illustrative, mais elle illustre magnifiquement je trouve. J'aime les personnages, les acteurs, comment Annaud a choisi de les représenter, j'aime le mystère qui règne en permanence, j'aime cette idée du livre tueur, tout ça est passionnant à mes yeux.sokol a écrit : ↑jeu. 21 mars 2024 10:55@groil_groil
Je sais bien que tu es méga fan de ce film mais je ne vois pas ce qu'on peut trouver cinématographiquement intéressant dans "Le nom de la rose"J'ai regardé 30-40 minutes (je l'avais vu il y a 30 ans mais à l'époque j'ai du voir un scénario quoi
) puis j'ai arrêté : je lui trouve aucun intérêt (à part découvrir qui-a-fait-ça, mais pour cela, il suffi de lire une page wiki du roman). C'était carrément insupportable

Aujourd'hui ce film est aussi important pour moi (ce n'est pas à cause de ça que je l'aime, mais cela fait partie du fait que j'y sois aussi attaché), parce que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma avec mon père. J'avais 15 ans, on y était allés avec mon meilleur pote et mon père donc, mais presque entre copains, et après la séance il nous avait payé des bières, je me souviens super bien de ce moment, l'un des plus beaux passés avec lui, et ça contribue aussi au fait que ce film est cher à mon coeur (mais NON Sokol ce n'est pas uniquement pour ça que je le défend
I like your hair.

Autant dire que c'était le film que j'attendais le plus depuis Cannes, et que je n'ai pas été déçu.
Du 1:33 au 1:66 et 1:85, les tailles des images évoluent en fonction des segments du film, d'un ratio à l'autre.
Chacune s'inscrit dans une époque, ou plutôt un type de représentations, de conceptions, de vérités ou de clichés. C'est peut-être dans ces glissements discrets que se cache le sens mystérieux du titre du film.
"Eureka", cri attribué à Archimède lors de sa compréhension de la "poussée" d'un volume sur l'autre, serait donc rejoué ici. L'eau de son bain serait l'écran de cinéma, espace de représentation, tandis que les poids que manipule le savant (comprendre, ici, le réalisateur) seraient les types d'images qui s'agencent les unes à la suite des autres (le volume devenant le format). Une image n'annule ni ne nie les autres, mais en décale la compréhension, les remodèle, reconfigure leurs lectures. Le film ressemble ainsi à une série de mondes gigognes aux perspective complémentaires. Quoi de moins surprenant pour un réalisateur ayant fait de la transversalité des temps et des mondes la matière même de son œuvre ?
Le film s'ouvre sur un western volontairement risible, pour ne pas dire mauvais, dans lequel tous les éléments semblent nous rappeler la construction cinématographique traditionnelle et son lot de poncifs : la photographie exagérée (des fausses ombres partout), les acteurs internationaux aux forts accents, le scénario absurde. Prenant à revers les attentes du connaisseur de son cinéma, Alonso à l'audace de ne pas lui faire un simple clin d’œil. Alors que tout réalisateur aurait fait durer cette scène quelques plans, Alonso lui donne une véritable existence et l'étend sur plus de 20 minutes, jusqu'à ce qu'un décentrement arrière nous face apparaitre ces images sur une télévision cathodique, dans le salon de l'héroïne de la deuxième partie du film.
Nous basculons de la sorte dans la vie de Alaina, policière dans la Réserve de Pine Ridge. Participant à l'une de ses patrouilles nous la suivons au grès des rencontres et des appels. Tandis que les codes numériques qu'elle ne cesse de répéter pour échanger avec ses collègues renforcent l’aliénation dont elle est sujette, la nuit environnante semblent figer à l'infini ses longs et lents déplacements, comme plongés par un désespoir immémorial. A cette noirceur répondra la blancheur immaculé du jour enneigé, ou pourra se matérialiser un échappatoire, non sans sacrifice.
Le temps, à nouveau, est ingrédient primordial du film. Une clé nous est donné lorsque le vieille homme, à la lisière de la 2ème et la 3ème partie, nous rappelle que le temps est, lui aussi, une fiction et que seul l'espace compte. Les choix de mise en scène d'Alonso, étirant ses scènes d'une façon hors-norme, semblent reconsidérer les possibles de son médium dont les idées structurantes sont mises à mal : nous ne sommes ici ni dans l'image-temps ni dans l'image-mouvement. Eureka nous propose quelque chose d'autre, encore non identifié qui ne manquera pas de pousser les spectateurices à questionner ses certitudes.
S'ouvrant vers l'animisme, Eureka prolonge l'expérience en adoptant enfin le point de vue d'un oiseau migrateur, retournant vers la foret tropicale du brésil, se rapprochant des premières amours d'Alonso. Nous y suivrons en parallèle deux choses : d'une part le quotidien d'une communauté autochtone nous narrant ses rêves, de l'autre l'établissement et le travail de chercheurs d'or. Tandis qu'au loin, insaisissable, le monde semble changer (fin de l'étalon-or annoncé à la radio, surgissement d'une canette de soda entre les rochers, passage d'un long train de fret parmi la foret), un des personnages passe des siens au travail d'orpailleur, semblant rejouer à des échelles macro et micro le processus de colonisation/modernisation occidental, aux effets funestes.
Étrangement, Eureka semble à la fois radicaliser (un temps dilaté de façon délirante, créant du "temps-espace") et simplifier (la question de décentrement et complémentarité des points de vue devient évidente) le cinéma du réalisateur argentin. Il semble également qu'Alonso reconfigure le rôle joué par les objets dans ses films. Jusqu'à présent les objets semblaient être pour lui des connecteurs de monde, tel des sortes de portails d'une réalité à une autre. Ce sont au contraire ici les objets qui circulent d'un monde à l'autre sans être pour autant des points de bascule. Plumes et couteaux (dont l'analogie formelle pourrait sans doute être discuté) réapparaissent ainsi sous divers rôles dans les trois segments du film, déjouant de la sorte des boucles et procédés attendus. Seule la toute dernière image, un plan fixe sur un couteau venant d'apparaitre, semble faire écho au plan final de Los Muertos (un long plan sur un minuscule jouet abandonné). Peut-être une façon pour Alonso de faire se rejoindre ses différents films, devenant de la sorte prolongements les uns des autres ?
Nous perdons donc ici un peu de la folie destrucuté de Liverpool (qu'un scénariste n'aurait pu envisager, tandis qu'ici leur présence se fait ici sentir) pour gagner - dans une certaine mesure - en clarté de lecture et de compréhension. Mais in-fine, un discours politique plus clair, sans perdre pour autant en radicalité artistique, n'est peut être pas un mal à l'heure de nos multiples crises et des besoins de redéfinitions que nous rencontrons.
@cyborg
Quelle est ta partie ‘préférée’, la deuxième (USA) ou troisième (le Brésil) ? (sachant que la première partie n’en est pas vraiment une, pour les raisons que tu évoques très justement (mauvais western etc etc)
Quelle est ta partie ‘préférée’, la deuxième (USA) ou troisième (le Brésil) ? (sachant que la première partie n’en est pas vraiment une, pour les raisons que tu évoques très justement (mauvais western etc etc)
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
@sokol : ha si, je pense que la première partie en est vraiment une et qu'elle est importante. Les tous premiers plans agglomèrent même les clichés de représentation des "indiens" : en pagne, à chanter au bord de la mer, puis debout sur une ligne de crête à observer le passage d'une carriole. Beaucoup est déjà dit ici.
Mais tu as raison je n'aurais pas dit que c'était "ma partie préférée"
J'aurais de toute façon du mal à classifier de la sorte ou du moins je ne vois pas trop le sens de le faire.
Je suis peut-être plus à l'aise avec "le Brésil" car cela ressemble plus à ce qu'on connait/attend d'Alonso, il y a la nature séduisante, les fondus-enchainé du rêve etc... Tandis que la partie "USA" me met plus à mal mais elle est aussi plus singulière, surprenante, perturbante.
Mais tu as raison je n'aurais pas dit que c'était "ma partie préférée"
J'aurais de toute façon du mal à classifier de la sorte ou du moins je ne vois pas trop le sens de le faire.
Je suis peut-être plus à l'aise avec "le Brésil" car cela ressemble plus à ce qu'on connait/attend d'Alonso, il y a la nature séduisante, les fondus-enchainé du rêve etc... Tandis que la partie "USA" me met plus à mal mais elle est aussi plus singulière, surprenante, perturbante.
Et sinon :
J'avais déjà croisé le travail d'Ana Vaz dans une installation vidéo au Palais de Tokyo, mais je n'en avais vu que quelques minutes, sans prendre le temps de m'y plonger.
Chose réparée grace à la soirée de projection à L'Archipel consacré à ses courts métrages :

Sacris Pulso - 2008
Film de found-footage, récupérant les plans d'un film de fiction sur Clarisse Lispector se passant à Brasilia, sur le tournage duquel se sont véritablement rencontré les parents de la réalisatrice. Le résultat est plutôt convaincant mais on sent surtout le film de jeunesse, manquant de véritable force propre ou d'originalité.

Entre Temps - 2012
Film de fin d'étude de la réalisatrice au Fresnoy. Méditation sur les formes de l'architecture moderne, plus précisément les grands ensembles, rapport entre corps, collectif, souvenirs intimes et partagés. Simple et beau, mais un peu trop léger, peut-être.

APIYEMIYEKÎ? - 2019
Film le plus singulier et convaincant de la sélection.
Vaz récupère et utilise les dessins et écritures diverses des Waimiri-Atroari lors de la première expérience d'alphabétisation à leur égard. Elle en fait le témoignage du massacre qu'a subi cette communauté à la même époque, lors de la construction à marche forcé d'une autoroute transamazonienne. Les traits se superposent aux paysages, aux corps, aux détails des habitations et des divers témoignages. On pense bien sur à l'incroyable "Iracema : Uma Transa Amazônica" de Jorge Bodansky, dans une version expérimentale et proche des communautés que la réalisatrice prend pour sujet. Les résonnances avec Eureka, vu la veille, sont fortes.
Curieux, j'ai ensuite été voir son premier long (1h06) métrage actuellement en salle, dont le beau titre m'intriguait

Si "il fait nuit en amérique", c'est bien sur de "nuit américaine" dont il est question.
Le tournoyant premier plan nous y plonge immédiatement, transformant progressivement Brasilia en une masse confuse et hypnotique, envoyant valdinguer au loin les humains que nous verrons très peu (ou du moins indirectement, par leurs constructions architecturales et leurs infatigables voitures) pour mieux faire de la faune locale le centre du film.
Ce premier film d'Ana Vaz pourrait presque être qualifié de "documentaire animalier expérimental", tentant d'adopter le point de vue des animaux que la construction de la cité moderniste a expulsé hors de leurs terres. Dès lors existent deux types de bêtes : ceux qui ont pu rester car on leur à fait une place, minuscule, dans des zoos arides, et ceux qui tentent de revenir sur leurs terres, déboussolés, rentrant dans les jardins et les maisons, épouvantant leurs habitants humains. Nous entendons alors ceux qui les soignent mais aussi ceux qu'on appelle pour les chasser. C'est sur cette fine ligne que Vaz filme les corps des animaux , et surtout leurs yeux, qui en retour semblent nous regarder et nous questionner sur la place que nous leurs avons laissé, que nous avons décidé d'occuper.
Quand à la fin du film la véritable nuit apparait, transformant notre civilisation en un ensemble de frêle traces lumineuses (phares, lampadaires, fenêtres allumérs), aucune réponse n'est donné, mais s'ouvre alors peut-être le possible d'un rêve reconfigurant nos rapports entre "nature" et "culture".

Étant en train de lire l'ouvrage de Mary Shelley, j'ai eu la curiosité de voir la comédie de Mel Brooks, encouragé par ma copine dont le film à bercé l'enfance, et par le nom de Brooks dont certaines œuvres (La folle histoire de l'espace notamment) m'avait beaucoup fait rire à l'adolescence. Je dois malheureusement avouer qu'entre jeux de mots et blagues de cul, le film m'a peu amusé et qu'il est surtout beaucoup trop long (1h50 !). Son âge de 50 ans (!) n'aide peut-être pas non plus, malheureusement.
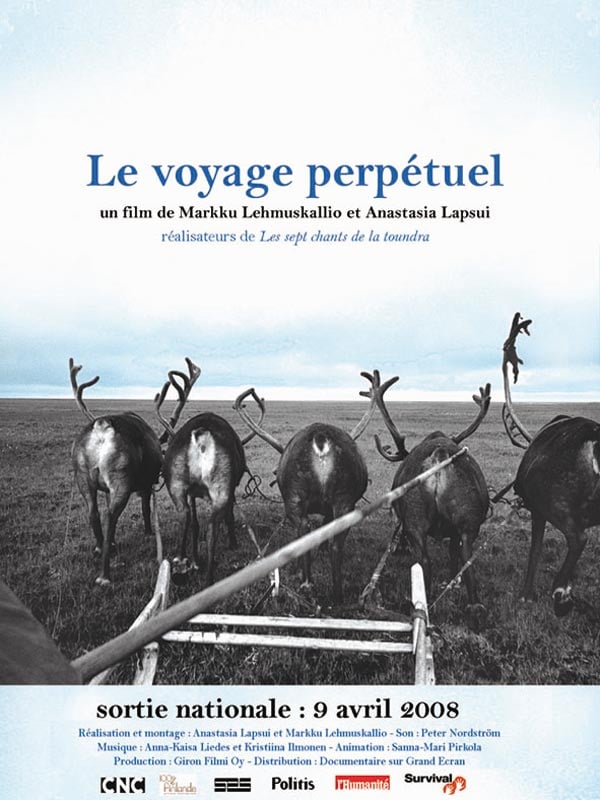
Découverte grâce à Tenk, qui leur consacre une mini-rétrospective, le travail du couple de réalisateur Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio.
Bien que paru en 2007, Le Voyage Perpétuel est composé de rush filmés au plus près du peuple Nénètse (dont est originaire Anastasia Lapsui) durant plusieurs décennies. Le fil rouge, lointain, du film est la grande migration des rennes qu'accompagne les nénètses. Les images sont absolument sublimes, tandis que les choix cinématographiques font du film un objet unique dans lequel chants, musiques, peintures, artisanat forment un tout indissociable. Lorsque la modernité apparait (la Sibérie était alors largement sous l'emprise soviétique) par des logements "en dur" ou des séances de travail extensifs, elle n'est jamais montré comme "meilleure" ou "enviable", juste "autre". Elle ne peut de toute façon rien contre le cycle immuable de la vie et de la mort. L'avant dernière scène est un examen médical, qui s'enchaine avec un enterrement traditionnel. Durant celui-ci on sculpte des formes d'étoiles à même le cercueil, notamment l'étoile du Nord, censé guider le défunt dans la nuit éternelle. Cette même étoile, en peinture à même la pellicule, ouvrait le film et accueillait les spectateurs dans les paysages de désert glacé de la Sibérie. Entre ces deux points, le temps semblait tout à fait relatif, passant sans distinctions de plans hivernaux à des plans printaniers, faisant des corps des humains et des animaux, nos seuls points de références communs. Toute une vision cosmogonique en une seule approche cinématographique. Magnifique.
J'avais déjà croisé le travail d'Ana Vaz dans une installation vidéo au Palais de Tokyo, mais je n'en avais vu que quelques minutes, sans prendre le temps de m'y plonger.
Chose réparée grace à la soirée de projection à L'Archipel consacré à ses courts métrages :

Sacris Pulso - 2008
Film de found-footage, récupérant les plans d'un film de fiction sur Clarisse Lispector se passant à Brasilia, sur le tournage duquel se sont véritablement rencontré les parents de la réalisatrice. Le résultat est plutôt convaincant mais on sent surtout le film de jeunesse, manquant de véritable force propre ou d'originalité.

Entre Temps - 2012
Film de fin d'étude de la réalisatrice au Fresnoy. Méditation sur les formes de l'architecture moderne, plus précisément les grands ensembles, rapport entre corps, collectif, souvenirs intimes et partagés. Simple et beau, mais un peu trop léger, peut-être.

APIYEMIYEKÎ? - 2019
Film le plus singulier et convaincant de la sélection.
Vaz récupère et utilise les dessins et écritures diverses des Waimiri-Atroari lors de la première expérience d'alphabétisation à leur égard. Elle en fait le témoignage du massacre qu'a subi cette communauté à la même époque, lors de la construction à marche forcé d'une autoroute transamazonienne. Les traits se superposent aux paysages, aux corps, aux détails des habitations et des divers témoignages. On pense bien sur à l'incroyable "Iracema : Uma Transa Amazônica" de Jorge Bodansky, dans une version expérimentale et proche des communautés que la réalisatrice prend pour sujet. Les résonnances avec Eureka, vu la veille, sont fortes.
Curieux, j'ai ensuite été voir son premier long (1h06) métrage actuellement en salle, dont le beau titre m'intriguait

Si "il fait nuit en amérique", c'est bien sur de "nuit américaine" dont il est question.
Le tournoyant premier plan nous y plonge immédiatement, transformant progressivement Brasilia en une masse confuse et hypnotique, envoyant valdinguer au loin les humains que nous verrons très peu (ou du moins indirectement, par leurs constructions architecturales et leurs infatigables voitures) pour mieux faire de la faune locale le centre du film.
Ce premier film d'Ana Vaz pourrait presque être qualifié de "documentaire animalier expérimental", tentant d'adopter le point de vue des animaux que la construction de la cité moderniste a expulsé hors de leurs terres. Dès lors existent deux types de bêtes : ceux qui ont pu rester car on leur à fait une place, minuscule, dans des zoos arides, et ceux qui tentent de revenir sur leurs terres, déboussolés, rentrant dans les jardins et les maisons, épouvantant leurs habitants humains. Nous entendons alors ceux qui les soignent mais aussi ceux qu'on appelle pour les chasser. C'est sur cette fine ligne que Vaz filme les corps des animaux , et surtout leurs yeux, qui en retour semblent nous regarder et nous questionner sur la place que nous leurs avons laissé, que nous avons décidé d'occuper.
Quand à la fin du film la véritable nuit apparait, transformant notre civilisation en un ensemble de frêle traces lumineuses (phares, lampadaires, fenêtres allumérs), aucune réponse n'est donné, mais s'ouvre alors peut-être le possible d'un rêve reconfigurant nos rapports entre "nature" et "culture".

Étant en train de lire l'ouvrage de Mary Shelley, j'ai eu la curiosité de voir la comédie de Mel Brooks, encouragé par ma copine dont le film à bercé l'enfance, et par le nom de Brooks dont certaines œuvres (La folle histoire de l'espace notamment) m'avait beaucoup fait rire à l'adolescence. Je dois malheureusement avouer qu'entre jeux de mots et blagues de cul, le film m'a peu amusé et qu'il est surtout beaucoup trop long (1h50 !). Son âge de 50 ans (!) n'aide peut-être pas non plus, malheureusement.
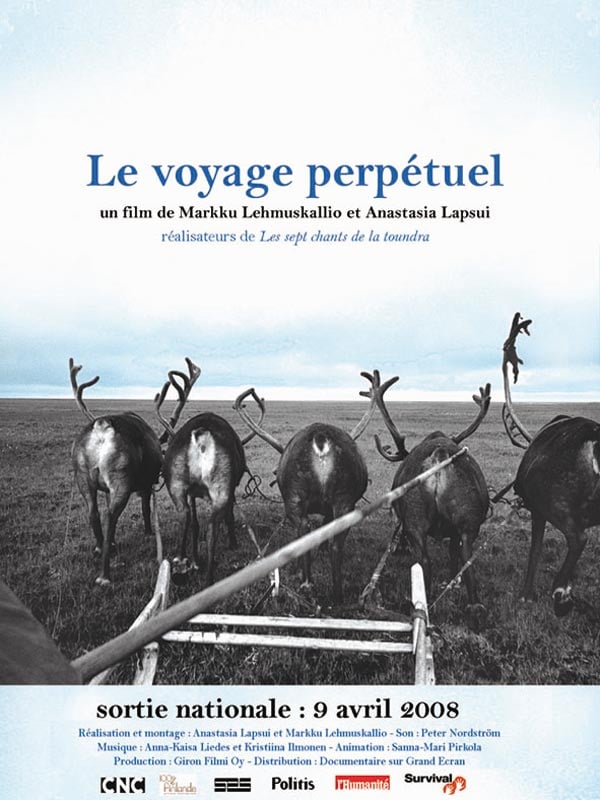
Découverte grâce à Tenk, qui leur consacre une mini-rétrospective, le travail du couple de réalisateur Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio.
Bien que paru en 2007, Le Voyage Perpétuel est composé de rush filmés au plus près du peuple Nénètse (dont est originaire Anastasia Lapsui) durant plusieurs décennies. Le fil rouge, lointain, du film est la grande migration des rennes qu'accompagne les nénètses. Les images sont absolument sublimes, tandis que les choix cinématographiques font du film un objet unique dans lequel chants, musiques, peintures, artisanat forment un tout indissociable. Lorsque la modernité apparait (la Sibérie était alors largement sous l'emprise soviétique) par des logements "en dur" ou des séances de travail extensifs, elle n'est jamais montré comme "meilleure" ou "enviable", juste "autre". Elle ne peut de toute façon rien contre le cycle immuable de la vie et de la mort. L'avant dernière scène est un examen médical, qui s'enchaine avec un enterrement traditionnel. Durant celui-ci on sculpte des formes d'étoiles à même le cercueil, notamment l'étoile du Nord, censé guider le défunt dans la nuit éternelle. Cette même étoile, en peinture à même la pellicule, ouvrait le film et accueillait les spectateurs dans les paysages de désert glacé de la Sibérie. Entre ces deux points, le temps semblait tout à fait relatif, passant sans distinctions de plans hivernaux à des plans printaniers, faisant des corps des humains et des animaux, nos seuls points de références communs. Toute une vision cosmogonique en une seule approche cinématographique. Magnifique.
- Tamponn Destartinn
- Messages : 1140
- Enregistré le : ven. 9 oct. 2020 21:11

Le titre est parlant. C'est le genre de film qui tient sur un pitch court et efficace, qui ne cherche à aller plus loin mais qui tient ses promesses.
Ce n'est pas du tout la même ambiance, mais c'est très comme Bis Repetita : bien, un peu attendu, tu sais très bien où ça va, mais avoir l'idée et la tenir c'est déjà pas donné à tout le monde et ça suffit pour faire un bon film.
Pourtant, je lisais hier le papier des Cahiers et ils disaient qu'il y a 2 parties (au USA et au Brésil) car le petit western est trop court pour qu'il fasse 'une partie'. Je ne suis donc pas le seul de penser ainsicyborg a écrit : ↑dim. 24 mars 2024 11:57@sokol : ha si, je pense que la première partie en est vraiment une et qu'elle est importante. Les tous premiers plans agglomèrent même les clichés de représentation des "indiens" : en pagne, à chanter au bord de la mer, puis debout sur une ligne de crête à observer le passage d'une carriole. Beaucoup est déjà dit ici.
Mais tu as raison je n'aurais pas dit que c'était "ma partie préférée"
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
Rhooo, j'ai juste dit que je n'étais pas le seul
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
La flamme verte - Mohammad Reza Aslani

Si vous le pouvez, courez voir cette merveille, c'est absolument magnifique. Comme d'autres ici, j'avais déjà beaucoup aimé le film récemment retrouvé et restauré de Reza Aslani, L'échiquier du vent (1976) et son atmosphère anxiogène, ouatée, ses éclairages si travaillés et le raffinement de sa mise en scène. La flamme verte est un film bien plus récent (2008) et pourtant il a le caractère et la texture des films intemporels des années 70, depuis le choix de la pellicule utilisée, jusqu'aux volées chromatiques qu'il déploie de son long et la narration qui enfouit conte dans le conte dans le conte pour aboutir à une structure polymorphe. C'est un enchantement de couleurs, de décors de châteaux en ruines (le palais principal où se concentre le récit vaut le coup d'œil à lui seul) et de légendes à la Mille et unes nuit (raconter des histoires tout le long du jour et de la nuit pour ressusciter son promis, au lieu de raconter pour survivre), tenu par des grands acteurs et actrices qui ne cessent de mourir et de renaître afin d'incarner tous les personnages de chaque histoire. Le film est aussi traversé par les chants sublimes d'un des (si ce n'est le plus) grand chanteur iranien (Mohammad Reza Shadjarian, décédé en 2022) au sommet de son art et sa voix magnifique qui m'a rapidement arraché des flots de larmes.
En fait c'est bien simple, j'ai tendance à devenir une rivière quand les films sont beaux, et là niveau compteur pluviométrie j'avais la barbe mouillée, faut le faire. Je veux dire, il y a des plans simplement hallucinant de beauté (des chevaux qui se battent devant une colline où s'enfuit une femme dont les tissus s'échappent au vent - un plan qui sort un peu brutalement, sans artifice ou musique grandiloquente pour te dire que c'est superbe, tu te prends juste ça dans la figure et tu te tais - il y a aussi des astuces visuelles très chouettes notamment à la fin où un stroboscope vient difracter le monde d'une femme qui comprend alors son erreur, petit délire visuel du réal), il y a l'évidence du montage qui peut être très nerveux quand il le faut et vraiment donner du relief aux séquences chantées ou dansées et puis il y a des plans plus sobres mais tout aussi merveilleux, magiques, dans la lignée d'un Paradjanov, plus simplement cadrés et frontaux, où les acteurs et actrices prennent la pose avec des objets. Le film est ainsi très varié dans son régime d'image mais aussi temporel. Car non seulement il faut raconter les 7 histoires (avec chacune son lots de costumes magnifiques qui renvoient à différentes époques de l'Iran) pour faire renaître le roi, mais en plus le film se paie le luxe d'avoir des flashbacks et des flashforwards par dessus tout cela et de situer son action principale dans les années 80. Il ne facilite pas vraiment la lecture du spectateur puisque les transitions sont parfois très minces voire absentes entre les trames et les lieux mais honnêtement aucun mal à suivre pour peu que l'on accroche un minimum.
Quel bonheur de voir autant de poésie, de spiritualité (le zoroastrisme étant référencé maintes fois dans le film) et de délicatesse, le tout habilement intégré à un récit plus vaste de l'Iran contemporain. Si vous voulez voir un film qui ne ménage pas son spectateur (volontiers cryptique par instants), mais qui va plutôt l'emmener rêver et apprécier le caractère magique de certains chiffres (Aleph qui donne lieu à la 3ème histoire), de tristesse infinie (beaucoup de récits finissent par des lapidations ou des ruines personnelles) ou simplement d'enchantement plastique, ruez vous sur ce chef d'œuvre.
- - -
Sinon j'ai revu Eureka (2024) et j'avoue que j'ai moins aimé la seconde fois... j'ai notamment vu un peu des faiblesses d'écriture de certaines scènes et j'ai été moins fasciné par l'ensemble -même si j'aime beaucoup la partie centrale où les personnages disparaissent les uns après les autres dans le froid. Je l'ai peut-être revu trop tôt mais il a un peu baissé dans mon estime. Disons que l'on voit tout de suite beaucoup plus les ficelles et que je m'en suis un peu lassé - de ce système.
Et revu aussi Les demoiselles de Rochefort, que du bonheur quoi. Je me dis que l'époque contemporaine manque cruellement d'un grand film musical de cette trempe - et je ne parle pas de Laland qui était au fond plus un film (beaucoup trop ?) nostalgique qu'une vraie proposition moderne. Le ciné a besoin d'un enchantement conscient comme l'étaient les films de Demy, avec tout le contexte historique qu'il faut (la guerre, qui revient toujours), la noirceur la plus totale (j'avais zappé mais dans les demoiselles il y a un meurtre sordide qui fait aussi partie de l'intrigue) tout cela mêlé à la magie de la musique et la folie de l'instant.

Si vous le pouvez, courez voir cette merveille, c'est absolument magnifique. Comme d'autres ici, j'avais déjà beaucoup aimé le film récemment retrouvé et restauré de Reza Aslani, L'échiquier du vent (1976) et son atmosphère anxiogène, ouatée, ses éclairages si travaillés et le raffinement de sa mise en scène. La flamme verte est un film bien plus récent (2008) et pourtant il a le caractère et la texture des films intemporels des années 70, depuis le choix de la pellicule utilisée, jusqu'aux volées chromatiques qu'il déploie de son long et la narration qui enfouit conte dans le conte dans le conte pour aboutir à une structure polymorphe. C'est un enchantement de couleurs, de décors de châteaux en ruines (le palais principal où se concentre le récit vaut le coup d'œil à lui seul) et de légendes à la Mille et unes nuit (raconter des histoires tout le long du jour et de la nuit pour ressusciter son promis, au lieu de raconter pour survivre), tenu par des grands acteurs et actrices qui ne cessent de mourir et de renaître afin d'incarner tous les personnages de chaque histoire. Le film est aussi traversé par les chants sublimes d'un des (si ce n'est le plus) grand chanteur iranien (Mohammad Reza Shadjarian, décédé en 2022) au sommet de son art et sa voix magnifique qui m'a rapidement arraché des flots de larmes.
En fait c'est bien simple, j'ai tendance à devenir une rivière quand les films sont beaux, et là niveau compteur pluviométrie j'avais la barbe mouillée, faut le faire. Je veux dire, il y a des plans simplement hallucinant de beauté (des chevaux qui se battent devant une colline où s'enfuit une femme dont les tissus s'échappent au vent - un plan qui sort un peu brutalement, sans artifice ou musique grandiloquente pour te dire que c'est superbe, tu te prends juste ça dans la figure et tu te tais - il y a aussi des astuces visuelles très chouettes notamment à la fin où un stroboscope vient difracter le monde d'une femme qui comprend alors son erreur, petit délire visuel du réal), il y a l'évidence du montage qui peut être très nerveux quand il le faut et vraiment donner du relief aux séquences chantées ou dansées et puis il y a des plans plus sobres mais tout aussi merveilleux, magiques, dans la lignée d'un Paradjanov, plus simplement cadrés et frontaux, où les acteurs et actrices prennent la pose avec des objets. Le film est ainsi très varié dans son régime d'image mais aussi temporel. Car non seulement il faut raconter les 7 histoires (avec chacune son lots de costumes magnifiques qui renvoient à différentes époques de l'Iran) pour faire renaître le roi, mais en plus le film se paie le luxe d'avoir des flashbacks et des flashforwards par dessus tout cela et de situer son action principale dans les années 80. Il ne facilite pas vraiment la lecture du spectateur puisque les transitions sont parfois très minces voire absentes entre les trames et les lieux mais honnêtement aucun mal à suivre pour peu que l'on accroche un minimum.
Quel bonheur de voir autant de poésie, de spiritualité (le zoroastrisme étant référencé maintes fois dans le film) et de délicatesse, le tout habilement intégré à un récit plus vaste de l'Iran contemporain. Si vous voulez voir un film qui ne ménage pas son spectateur (volontiers cryptique par instants), mais qui va plutôt l'emmener rêver et apprécier le caractère magique de certains chiffres (Aleph qui donne lieu à la 3ème histoire), de tristesse infinie (beaucoup de récits finissent par des lapidations ou des ruines personnelles) ou simplement d'enchantement plastique, ruez vous sur ce chef d'œuvre.
- - -
Sinon j'ai revu Eureka (2024) et j'avoue que j'ai moins aimé la seconde fois... j'ai notamment vu un peu des faiblesses d'écriture de certaines scènes et j'ai été moins fasciné par l'ensemble -même si j'aime beaucoup la partie centrale où les personnages disparaissent les uns après les autres dans le froid. Je l'ai peut-être revu trop tôt mais il a un peu baissé dans mon estime. Disons que l'on voit tout de suite beaucoup plus les ficelles et que je m'en suis un peu lassé - de ce système.
Et revu aussi Les demoiselles de Rochefort, que du bonheur quoi. Je me dis que l'époque contemporaine manque cruellement d'un grand film musical de cette trempe - et je ne parle pas de Laland qui était au fond plus un film (beaucoup trop ?) nostalgique qu'une vraie proposition moderne. Le ciné a besoin d'un enchantement conscient comme l'étaient les films de Demy, avec tout le contexte historique qu'il faut (la guerre, qui revient toujours), la noirceur la plus totale (j'avais zappé mais dans les demoiselles il y a un meurtre sordide qui fait aussi partie de l'intrigue) tout cela mêlé à la magie de la musique et la folie de l'instant.
@Narval : oui je n'aurais pas revu aussi vite que toi Eureka. Même si j'ai beaucoup aimé, je n'y suis pas près. Et je comprends tout à fait la faiblesse que tu pointes, les "faiblesses d'écritures" qui peuvent apparaitre. Moi je pense que c'est la faute des scénaristes plus que d'Alonso 
Bref.
D'aucun auront remarqué que j'essaie de regarder un maximum de cinéma "du monde". J'ai aussi envie de voir plus de cinéma réalisé par des femmes (ce que je fais depuis longtemps dans mes lectures). Je dois bien avouer que lier les deux n'est pas facile du tout ! J'avance et flaire pas à pas...
Récemment :

La métamorphose des oiseaux - Catarina Vasconcelos - 2020
Je n'avais jamais entendu parler de ce film, et je crois qu'il n'a pas atteint les écrans français... Sa parution (diffusion en festival j'imagine) en 2020 n'a sans doute pas joué en sa faveur. J'espère que cela ne causera pas de tors à la réalisatrice car ce premier long métrage est très beau.
Qu'est-ce qui, en 2020, peut pousser une artiste à faire un film en pellicule (en 16mm j'imagine, pardon je ne suis pas sur de savoir nommer exactement le choix de la réal. A moins que ce ne soit que des filtres d'effets ? Mais ce n'est pas trop grave pour le cas présent...) ? Outre la question esthétique (tonalité des couleurs, format d'image...) nous pouvons songer à la présence de l'image elle même. Tandis que la course vers la "haute définition" tend à faire "oublier l'image" qui se présente alors comme une inquestionnable "représentation du réel", le 16mm, lui, le met à distance.
De la même façon, en choisissant la forme du conte, ou plutôt de la somme de petites histoires, Vasconcelos se et nous détache de l'illusion classique du cinéma et ne prétend à aucune véracité évidente.
C'est avec cet alliage poussant à l'observation et à la méditation qu'elle nous entraine dans l'histoire d'une mystérieuse famille (la sienne, peut-être ?) qui s’entremêle avec l'Histoire du Portugal moderne.
Un père et une mère qui s'aiment et donnent naissance à 7 enfants, 6 garçons et une fille, la narratrice et voix-off. Le père est absent, au loin, marin de par le monde, ne rentre presque jamais et ne voit grandir ses enfants que par les photographies ou les lettres qu'il reçoit. La mère, seule et forte, tente d’élever sa famille comme elle le peut. Le temps passe, les enfants deviennent adultes et les rôles s'échangent, la mort frappe, les époques, les souvenirs, les désirs se mélangent.
Il y a quelque chose du territoire dans La Métamorphose des Oiseaux : territoire géographique, mais plus encore de territoires intimes, de territoire des perceptions, des imaginations et des savoirs. Chacun se superpose et se redéfinit, évoluant les uns des autres sans forme définitive.
Tout le film est un agrégat de petites scènettes, d'expériences visuelles, de sensations, passant de l'infiniment petit au paysage, de l'anecdote intime à la politique internationale. Pris séparément, les bouts n'auraient pas grand intérêt, et l'on aurait l'impression d'une juxtaposition d'idées approximatives, comme dans le jury d'un étudiant en art. Car il y a quelques choses de l'art contemporain dans l'essai réalisé par Catarina Vasconcelos, par ses explorations plastiques et narratives. On pense d'ailleurs, pour rester dans les références lusophone, à une rencontre entre le duo de plasticien João Maria Gusmão & Pedro Paiva avec Miguel Gomes, période extensive des Milles et Unes Nuits. Il est néanmoins évident qu'ici le tout est davantage que la somme de ses parties, aboutissant à un résultat doux et envoutant, dont l'aspect vaporeux n'oublie néanmoins pas de poser des questions politiques importantes.
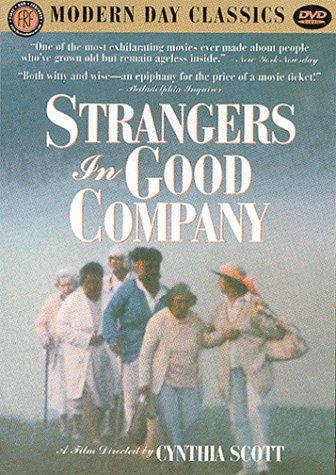
The Company of Strangers - Cynthia Scott - Canada - 1990
Un bus de tourisme tombe en panne au beau milieu de la nature canadienne. A son bord : 7 femmes âgées (de 70 à 80 ans) et une conductrice d'une 30aine d'années. Elles se retrouvent contraintes de trouver refuge dans une petite maison abandonnée et devront s'entraider pour trouver un minimum de confort pour dormir, trouver de quoi manger, essayer d'appeler à l'aide etc, le temps que le bus soit réparé par la plus mécanicienne du groupe.
Tout cet habillage "story telling" du film est totalement à la sauce américaine, dans sa mise en scène, ses choix esthétiques etc et n'a rien d'enthousiasmant.
Mais c'est néanmoins seulement à travers lui que nous pouvons atteindre ce qui constitue le cœur véritable - et l'intérêt même - du film : à savoir les discussions libres entre les personnages. Ce que j'ignorais (je l'ai appris en lisant après le film) est que ces 8 femmes ne se connaissaient pas et font donc connaissances durant le tournage et devant la caméra, donnant soudainement au film une dimension documentaire. En naissent des témoignages très touchant sur leurs vies, leurs choix, leurs conditions de travail, leurs orientations sexuelles, etc... au beau milieu du cadre atypique des grands espaces nord-américains. Il y a bien sur un gros travail de montage et sans doute de la prépa etc, mais néanmoins l'effet fonctionne et leurs histoires/témoignages accèdent à une véritable existence.
Ce type de personnages et de discours étant si rare au cinéma (qui filme sérieusement la parole du 3ème - pour ne pas dire 4ème - age au cinéma, et de femmes de surcroit ?) que le film se révèle beaucoup plus précieux qu'il n'en avait l'air au premier abord. The Company of Strangers (également nommé '"Strangers in Good Company") a semble-t-il connu un beau succès populaire à l'époque de sa sortie. Et quand on y pense, il est assez fou de constater la lourdeur de l'appareillage narratif et "entertainement" qu'il faut mettre en place pour rendre audible/visible/acceptable des corps et paroles habituellement totalement invisibilisé. Ceci ferait presque du film un cas d'école pour comprendre le rapport à l'image et à la création de notre époque et culture.
Revu, à l'occasion d'un festival de performance :

que j'avais déjà eu la chance de voir en salle et que j'ai donc revu dans les mêmes bonnes conditions.
Toujours aussi génial, d'une radicalité indécrottable tendant à l'hypnose. Quelques points que j'avais oublié ou qui m'avait échappé à l'époque :
-le son. Peut être était-il un peu trop fort lors de cette projection, mais j'avais oublié qu'il était aussi envahissant, excessivement pressant jusqu'à l'excés, bien qu'il participe à la force du film
-j'avais oublié qu'en quasi hors-champs il y avait (ce qu'on suppose être) un meurtre, puis un coup de fil à ce sujet. Génial. Le film est donc "narratif" et en choisissant le motif du crime/enquête il est donc possible avec Wavelenght de faire rentre le cinéma structurel dans la discussion sur les images qui traverse le cinéma moderne de la même époque et de la même manière (j'ai en tête Blow up et Profession : Reporter)
-je croyais qu'à la toute fin la fameuse image de mer se mettait en mouvement. Ou du moins qu'on entendait soudainement le bruit de la mer. Ce n'est pas le cas et peut être tant mieux, car le film aurait alors raconté tout à fait autre chose.

Là encore, la sortie du film début 2020 n'a pas du aider à en entendre parler, mais il faut aussi dire qu'on est loin de ce que Porumboiu à fait de mieux.
Le pitch et le titre (mais ce n'est pas celui choisi pour la version roumaine qui est "La Gomera", soit l'ile ou se passe un bout de l'intrigue et annonce donc une autre tonalité) laisse espérer que la fascinante "langue sifflée" soit un vrai enjeu cinématographique, or elle n'est que largement secondaire. Assez dommage de la part d'un cinéaste qui s'intéresse à la question du langage depuis ses débuts.
Le tout est enrobé d'un décorum de film policier (autre point récurrent du travail du réalisateur) mais qui n'est jamais traité de façon convaincante, Porumboiu préférant le mettre en abyme pour tenter d'élaborer un discours sur le cinéma et la mise en scène. Le problème est qu'aucun des deux niveaux ne fonctionne, le réalisateur se moque de son intrigue (et nous aussi) tandis que ses tentatives conceptuelles semblent lourdingues et diligente ( les caméras de surveillances, la réunion au cinéma devant "The searchers", la prise d'otage dans un décor de cinéma, le réalisateur-touriste qu'on exécute sans sommation, etc etc).
J'ai fini par penser à un autre film vu récemment, Péril en la demeure de Michel Delville. Les deux films sont extrêmement différents évidemment, mais tous les deux partagent cette envie de conceptualiser leur approche et partage le même regard tourné vers De Palma, sans lui arriver à la cheville. Porumboiu se permet même une référence directe à la "scène de la douche", tandis que je suis certain que son plan final sur les dégoutant "arbres lumineux" de Singapour sont un clin d'oeil aux feux d'artifices finaux de Blow Out, dans une version encore plus artificialisée et spectaculaire. Pourquoi pas, mais à quoi bon, et surtout quel construction laborieuse pour déboucher là. Bref ce virage quasi-pop (les personnages par couleur...) du réalisateur n'est pas des plus convaincants et on lui souhaite de revenir à l'ascèse captivante qui avait fait la force de Policier, adjective il y a quelques années.
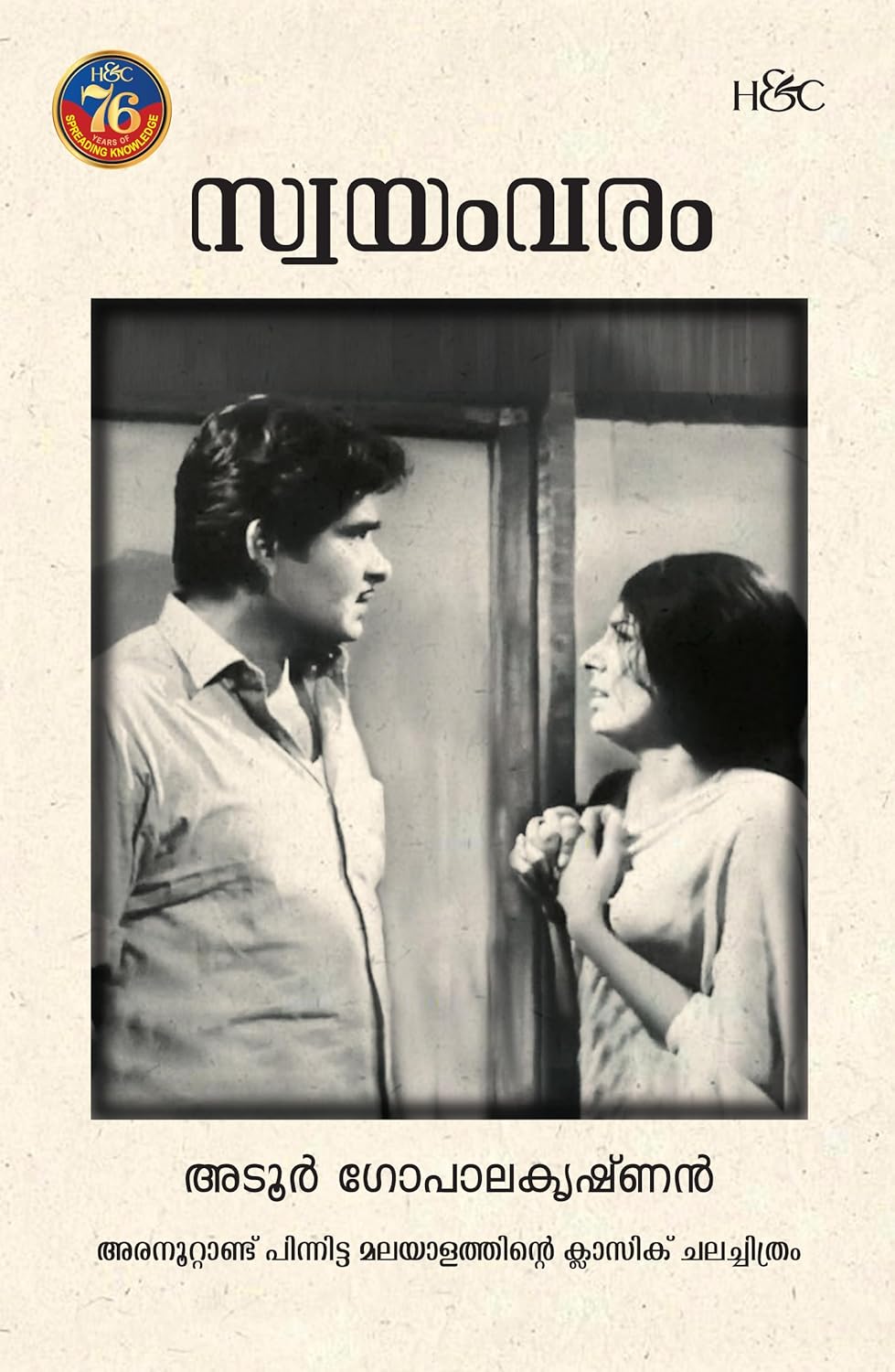
Swayamvaram (Son propre choix) - Adoor Gopalakrishnan - 1972
Gopalakrishnan fait partie de mes meilleures découvertes du cinéma indien. Je me rend compte qu'une bonne part de mes découvertes se concentrent en réalité sur la région du Kerala qui semble dotée d'une riche scène cinématographique.
Premier long-métrage du réalisateur, Swayamvaram contient déjà ce qui fera le fil rouge de tout son travail (du moins ce que j'en ai vu), à savoir l'aliénation et plus précisément l'aliénation sociale.
Un jeune couple, marié librement et contre l'avis de leurs familles, passe d'une lune de miel idyllique aux dures réalités de leur installation et de leur nouvelle vie quotidienne. Très pessimiste, le film est une longue et lente descente descente aux enfers pour les deux personnages. Les trois trames récurrente du cinéma indien (l'amour, l'art, la politique) sont bien présentes ici, mais toujours repoussés comme des idéaux inatteignables, mis à mal par la matérialité du quotidien. La mise en scène très précise du réalisateur fonctionne déjà à merveille et soutien avec adresse le commentaire politique amer qui est ici présenté.

Flamenco at 5:15 - Cynthia Scott - 1983
Une des rares autres création de Cynthia Scott, réalisatrice de "The company of strangers" cité ci-dessus, un cancer ayant semble-t-il compromis la suite de sa carrière.
Court-métrage documentaire adoubé d'un oscar, Flamenco at 5:15 se concentre sur une classe de haut niveau de flamenco donné par un vieux couple de professeur. Les jeunes danseur.se.s sont uniquement présents par leurs corporéités et leurs positions d'apprenants mais n'ont aucune autre existence à l'image : ils ne sont pas interviewés et on ne les entend jamais parler. Au contraire, ils servent à mettre en avant le couple de professeur et tout particulièrement Susana Robledo, qui incarne le véritable point d'intéret de la réalisatrice.
Comme dans son long métrage il y a donc à nouveau tout un appareillage (les images sont très travaillés avec des mouvements d'appareils et il y a surement de nombreux éclairages en hors champ) afin de faire apparaitre le corps, la voix et l'histoire d'une femme du 3ème age. Il en ressort un beau jeu de mise en espace entre ce corps vieillissant mais magnifique du quel déborde le savoir, l'énergie, la passion qui vient se démultiplier dans les corps jeunes et frais des élèves.
Bref.
D'aucun auront remarqué que j'essaie de regarder un maximum de cinéma "du monde". J'ai aussi envie de voir plus de cinéma réalisé par des femmes (ce que je fais depuis longtemps dans mes lectures). Je dois bien avouer que lier les deux n'est pas facile du tout ! J'avance et flaire pas à pas...
Récemment :

La métamorphose des oiseaux - Catarina Vasconcelos - 2020
Je n'avais jamais entendu parler de ce film, et je crois qu'il n'a pas atteint les écrans français... Sa parution (diffusion en festival j'imagine) en 2020 n'a sans doute pas joué en sa faveur. J'espère que cela ne causera pas de tors à la réalisatrice car ce premier long métrage est très beau.
Qu'est-ce qui, en 2020, peut pousser une artiste à faire un film en pellicule (en 16mm j'imagine, pardon je ne suis pas sur de savoir nommer exactement le choix de la réal. A moins que ce ne soit que des filtres d'effets ? Mais ce n'est pas trop grave pour le cas présent...) ? Outre la question esthétique (tonalité des couleurs, format d'image...) nous pouvons songer à la présence de l'image elle même. Tandis que la course vers la "haute définition" tend à faire "oublier l'image" qui se présente alors comme une inquestionnable "représentation du réel", le 16mm, lui, le met à distance.
De la même façon, en choisissant la forme du conte, ou plutôt de la somme de petites histoires, Vasconcelos se et nous détache de l'illusion classique du cinéma et ne prétend à aucune véracité évidente.
C'est avec cet alliage poussant à l'observation et à la méditation qu'elle nous entraine dans l'histoire d'une mystérieuse famille (la sienne, peut-être ?) qui s’entremêle avec l'Histoire du Portugal moderne.
Un père et une mère qui s'aiment et donnent naissance à 7 enfants, 6 garçons et une fille, la narratrice et voix-off. Le père est absent, au loin, marin de par le monde, ne rentre presque jamais et ne voit grandir ses enfants que par les photographies ou les lettres qu'il reçoit. La mère, seule et forte, tente d’élever sa famille comme elle le peut. Le temps passe, les enfants deviennent adultes et les rôles s'échangent, la mort frappe, les époques, les souvenirs, les désirs se mélangent.
Il y a quelque chose du territoire dans La Métamorphose des Oiseaux : territoire géographique, mais plus encore de territoires intimes, de territoire des perceptions, des imaginations et des savoirs. Chacun se superpose et se redéfinit, évoluant les uns des autres sans forme définitive.
Tout le film est un agrégat de petites scènettes, d'expériences visuelles, de sensations, passant de l'infiniment petit au paysage, de l'anecdote intime à la politique internationale. Pris séparément, les bouts n'auraient pas grand intérêt, et l'on aurait l'impression d'une juxtaposition d'idées approximatives, comme dans le jury d'un étudiant en art. Car il y a quelques choses de l'art contemporain dans l'essai réalisé par Catarina Vasconcelos, par ses explorations plastiques et narratives. On pense d'ailleurs, pour rester dans les références lusophone, à une rencontre entre le duo de plasticien João Maria Gusmão & Pedro Paiva avec Miguel Gomes, période extensive des Milles et Unes Nuits. Il est néanmoins évident qu'ici le tout est davantage que la somme de ses parties, aboutissant à un résultat doux et envoutant, dont l'aspect vaporeux n'oublie néanmoins pas de poser des questions politiques importantes.
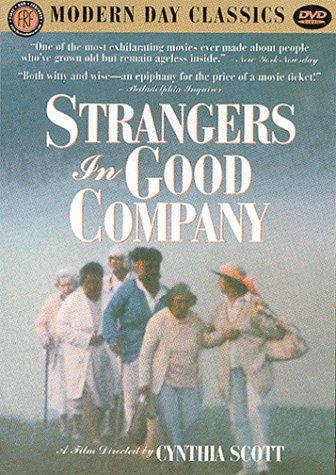
The Company of Strangers - Cynthia Scott - Canada - 1990
Un bus de tourisme tombe en panne au beau milieu de la nature canadienne. A son bord : 7 femmes âgées (de 70 à 80 ans) et une conductrice d'une 30aine d'années. Elles se retrouvent contraintes de trouver refuge dans une petite maison abandonnée et devront s'entraider pour trouver un minimum de confort pour dormir, trouver de quoi manger, essayer d'appeler à l'aide etc, le temps que le bus soit réparé par la plus mécanicienne du groupe.
Tout cet habillage "story telling" du film est totalement à la sauce américaine, dans sa mise en scène, ses choix esthétiques etc et n'a rien d'enthousiasmant.
Mais c'est néanmoins seulement à travers lui que nous pouvons atteindre ce qui constitue le cœur véritable - et l'intérêt même - du film : à savoir les discussions libres entre les personnages. Ce que j'ignorais (je l'ai appris en lisant après le film) est que ces 8 femmes ne se connaissaient pas et font donc connaissances durant le tournage et devant la caméra, donnant soudainement au film une dimension documentaire. En naissent des témoignages très touchant sur leurs vies, leurs choix, leurs conditions de travail, leurs orientations sexuelles, etc... au beau milieu du cadre atypique des grands espaces nord-américains. Il y a bien sur un gros travail de montage et sans doute de la prépa etc, mais néanmoins l'effet fonctionne et leurs histoires/témoignages accèdent à une véritable existence.
Ce type de personnages et de discours étant si rare au cinéma (qui filme sérieusement la parole du 3ème - pour ne pas dire 4ème - age au cinéma, et de femmes de surcroit ?) que le film se révèle beaucoup plus précieux qu'il n'en avait l'air au premier abord. The Company of Strangers (également nommé '"Strangers in Good Company") a semble-t-il connu un beau succès populaire à l'époque de sa sortie. Et quand on y pense, il est assez fou de constater la lourdeur de l'appareillage narratif et "entertainement" qu'il faut mettre en place pour rendre audible/visible/acceptable des corps et paroles habituellement totalement invisibilisé. Ceci ferait presque du film un cas d'école pour comprendre le rapport à l'image et à la création de notre époque et culture.
Revu, à l'occasion d'un festival de performance :

que j'avais déjà eu la chance de voir en salle et que j'ai donc revu dans les mêmes bonnes conditions.
Toujours aussi génial, d'une radicalité indécrottable tendant à l'hypnose. Quelques points que j'avais oublié ou qui m'avait échappé à l'époque :
-le son. Peut être était-il un peu trop fort lors de cette projection, mais j'avais oublié qu'il était aussi envahissant, excessivement pressant jusqu'à l'excés, bien qu'il participe à la force du film
-j'avais oublié qu'en quasi hors-champs il y avait (ce qu'on suppose être) un meurtre, puis un coup de fil à ce sujet. Génial. Le film est donc "narratif" et en choisissant le motif du crime/enquête il est donc possible avec Wavelenght de faire rentre le cinéma structurel dans la discussion sur les images qui traverse le cinéma moderne de la même époque et de la même manière (j'ai en tête Blow up et Profession : Reporter)
-je croyais qu'à la toute fin la fameuse image de mer se mettait en mouvement. Ou du moins qu'on entendait soudainement le bruit de la mer. Ce n'est pas le cas et peut être tant mieux, car le film aurait alors raconté tout à fait autre chose.

Là encore, la sortie du film début 2020 n'a pas du aider à en entendre parler, mais il faut aussi dire qu'on est loin de ce que Porumboiu à fait de mieux.
Le pitch et le titre (mais ce n'est pas celui choisi pour la version roumaine qui est "La Gomera", soit l'ile ou se passe un bout de l'intrigue et annonce donc une autre tonalité) laisse espérer que la fascinante "langue sifflée" soit un vrai enjeu cinématographique, or elle n'est que largement secondaire. Assez dommage de la part d'un cinéaste qui s'intéresse à la question du langage depuis ses débuts.
Le tout est enrobé d'un décorum de film policier (autre point récurrent du travail du réalisateur) mais qui n'est jamais traité de façon convaincante, Porumboiu préférant le mettre en abyme pour tenter d'élaborer un discours sur le cinéma et la mise en scène. Le problème est qu'aucun des deux niveaux ne fonctionne, le réalisateur se moque de son intrigue (et nous aussi) tandis que ses tentatives conceptuelles semblent lourdingues et diligente ( les caméras de surveillances, la réunion au cinéma devant "The searchers", la prise d'otage dans un décor de cinéma, le réalisateur-touriste qu'on exécute sans sommation, etc etc).
J'ai fini par penser à un autre film vu récemment, Péril en la demeure de Michel Delville. Les deux films sont extrêmement différents évidemment, mais tous les deux partagent cette envie de conceptualiser leur approche et partage le même regard tourné vers De Palma, sans lui arriver à la cheville. Porumboiu se permet même une référence directe à la "scène de la douche", tandis que je suis certain que son plan final sur les dégoutant "arbres lumineux" de Singapour sont un clin d'oeil aux feux d'artifices finaux de Blow Out, dans une version encore plus artificialisée et spectaculaire. Pourquoi pas, mais à quoi bon, et surtout quel construction laborieuse pour déboucher là. Bref ce virage quasi-pop (les personnages par couleur...) du réalisateur n'est pas des plus convaincants et on lui souhaite de revenir à l'ascèse captivante qui avait fait la force de Policier, adjective il y a quelques années.
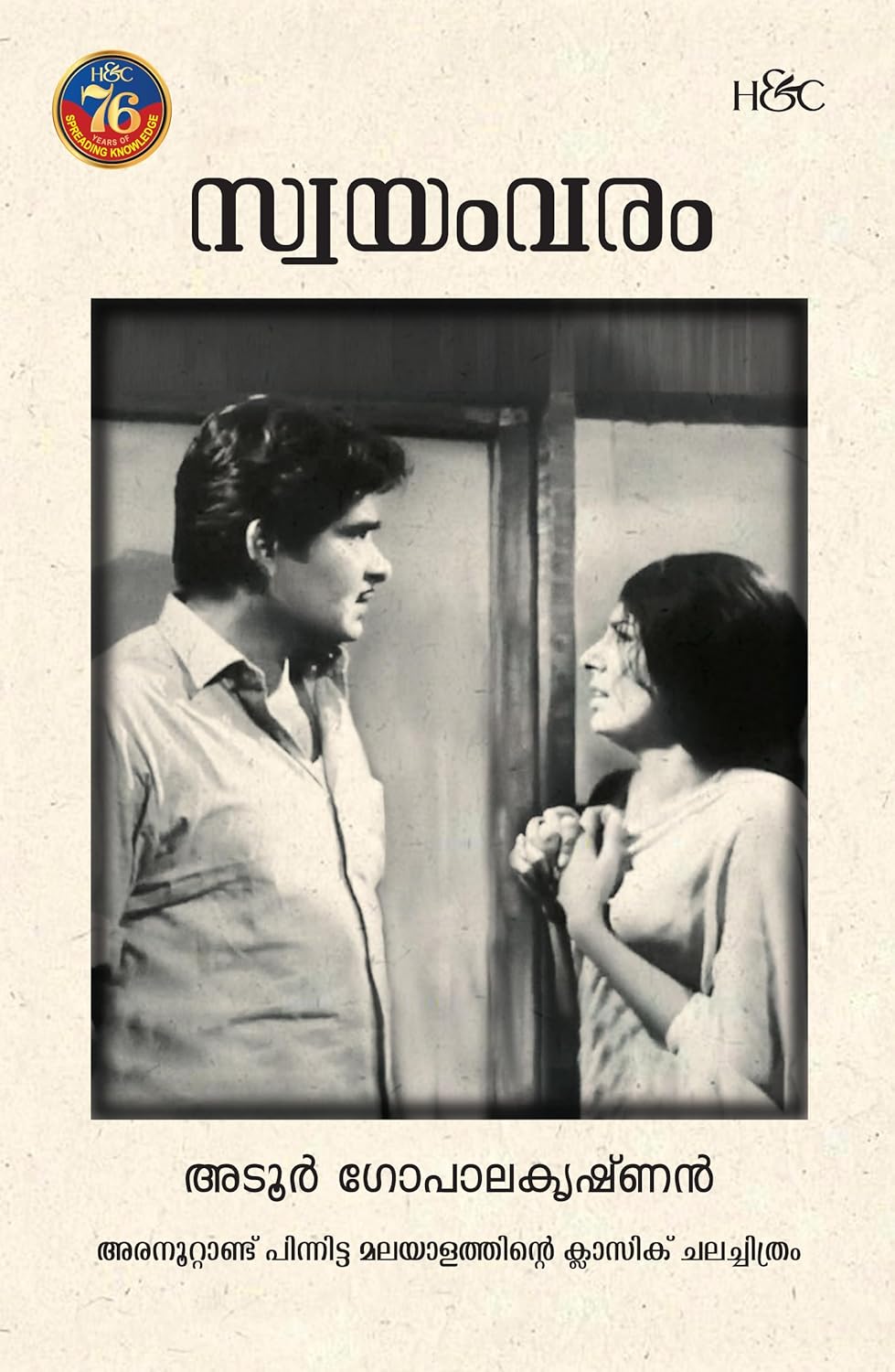
Swayamvaram (Son propre choix) - Adoor Gopalakrishnan - 1972
Gopalakrishnan fait partie de mes meilleures découvertes du cinéma indien. Je me rend compte qu'une bonne part de mes découvertes se concentrent en réalité sur la région du Kerala qui semble dotée d'une riche scène cinématographique.
Premier long-métrage du réalisateur, Swayamvaram contient déjà ce qui fera le fil rouge de tout son travail (du moins ce que j'en ai vu), à savoir l'aliénation et plus précisément l'aliénation sociale.
Un jeune couple, marié librement et contre l'avis de leurs familles, passe d'une lune de miel idyllique aux dures réalités de leur installation et de leur nouvelle vie quotidienne. Très pessimiste, le film est une longue et lente descente descente aux enfers pour les deux personnages. Les trois trames récurrente du cinéma indien (l'amour, l'art, la politique) sont bien présentes ici, mais toujours repoussés comme des idéaux inatteignables, mis à mal par la matérialité du quotidien. La mise en scène très précise du réalisateur fonctionne déjà à merveille et soutien avec adresse le commentaire politique amer qui est ici présenté.

Flamenco at 5:15 - Cynthia Scott - 1983
Une des rares autres création de Cynthia Scott, réalisatrice de "The company of strangers" cité ci-dessus, un cancer ayant semble-t-il compromis la suite de sa carrière.
Court-métrage documentaire adoubé d'un oscar, Flamenco at 5:15 se concentre sur une classe de haut niveau de flamenco donné par un vieux couple de professeur. Les jeunes danseur.se.s sont uniquement présents par leurs corporéités et leurs positions d'apprenants mais n'ont aucune autre existence à l'image : ils ne sont pas interviewés et on ne les entend jamais parler. Au contraire, ils servent à mettre en avant le couple de professeur et tout particulièrement Susana Robledo, qui incarne le véritable point d'intéret de la réalisatrice.
Comme dans son long métrage il y a donc à nouveau tout un appareillage (les images sont très travaillés avec des mouvements d'appareils et il y a surement de nombreux éclairages en hors champ) afin de faire apparaitre le corps, la voix et l'histoire d'une femme du 3ème age. Il en ressort un beau jeu de mise en espace entre ce corps vieillissant mais magnifique du quel déborde le savoir, l'énergie, la passion qui vient se démultiplier dans les corps jeunes et frais des élèves.
@cyborg javais beaucoup aimé «Les siffleurs» ! Je ne vois pas pourquoi tu dis que la "langue sifflée" n'est que secondaire or le film réussi bien la confrontation constante entre image et langage.
Le dernier plan est magistral et ironique au possible (on a eu une dispute cinématographique avec @asketoner car il ne voyait pas l’ironie de le scène) et je ne vois pas pourquoi il serait ‘tout ça pour ça’

Le dernier plan est magistral et ironique au possible (on a eu une dispute cinématographique avec @asketoner car il ne voyait pas l’ironie de le scène) et je ne vois pas pourquoi il serait ‘tout ça pour ça’
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
Le mal n'existe pas - Ryūsuke Hamaguchi

Passons le titre pompeux et les figures archétypales parmi les personnages qui sont certes un peu limitantes, passons aussi le suspens du final qui est très fabriqué et pas très intéressant, je trouve l'écriture vraiment toujours aussi belle. Plus encore, la mise en scène permet à l'ensemble d'être constamment juste et percutant alors que les situations sont assez attendues. Hamagushi a toujours le goût pour les longues scènes de réunion où chaque personnage peut prendre son temps de parole et briller un instant. Il y en a plusieurs dans ce cru qui sont vraiment réussies. Plus exactement, il y en a une par côté de l'équation, et la première, celle du village, est évidemment bien plus fouillée et complexe. Cette séquence en particulier, permet vraiment d'irriguer un peu tout le reste de la narration, en présentant, un à un, chaque membre de la communauté qu'il faudra apprendre - à peut-être - découvrir. Le projet de construction de ce super camping glamour (dit "glamping", une vraie tendance pas si récente que je ne connaissais pas du tout et qui a l'air d'être un vrai fléau dans certains coins) est évidemment trop énorme, absurde pour être est vraie et pourtant cela fonctionne car porté par un duo de représentant tout penauds et timides, que l'on finit bien vite par trouver aussi attachant que les locaux. Lorsque le type avoue en se surprenant lui-même qu'il n'avais pas vécu un moment aussi fort dans sa vie que de couper une buche, et qu'il compte bien rester plus longtemps, on ne peut pas s'empêcher d'être à la fois attendri et pris de pitié. C'est ce mélange je pense qui fait aussi la force des personnages et permet de dépasser leurs situations à priori trop facilement résolues.
Si l'enjeu du film semble être de protéger l'équilibre - ou du moins une notion d'équilibre théorisée et nécessairement biaisée - entre humanité et nature, le film prend pour moi définitivement parti pour la toute puissance - mais aussi la complexité - du vivant, dans sa plus générale définition. Les séquences en forêt sont irriguées par ce thème bien violoneux à la fois beau, tragique et angoissant, qui ne cesse de fluctuer entre accords, et représente assez bien la complexité de ce paysage mouvant, de ces arbres vues en contre-plongée qui sont dès le début autant refuge apaisant que dédale menaçant, propre à la perdition et à la mélancholie. On est pas si loin d'une vision romancée - voire romantisée de la nature, avec ces accents symphoniques et le lyrisme des mouvements de caméra, avec sa faune craintive et ses arbres décharnés très efficaces visuellement -, et pourtant je trouve que le film arrive à insuffler une atmosphère vraiment forte à ses moments forestiers. Au delà de l'ambiance, il y a la patience avec laquelle le film démarre, sans dialogue, pendant un bon quart d'heure, et où tout est encore possible. La campagne c'est aussi la solitude, parfois la vie qui peut être très rude et la galère pour le moindre problème de santé... Dans ce film on voit un peu la solitude, mais peut-être du point de vue d'un scénariste (la figure du père célibataire taiseux), pas forcément très intéressante. Et pourtant je trouve que même ce personnage existe aussi, alors qu'il est très basique, car le film parvient à trouver le temps pour filmer ses gestes sans en faire trop, dans son opposition un peu factice avec les deux émissaires du capitalisme branché.
A cette opposition facile et trop rapide du romantisme de la nature et de la rapidité inhumaine de la ville, la fin du film vient répondre avec un accès de violence que j'ai trouvé à la fois innnattendu et en même temps plutôt pertinent. La vision romantique prend ici donc fin.
A noter que le(s) générique(s) sont vraiment très très courts, il me semble même pas avoir vu de véritable équipe technique créditée, j'ai rêvé ou bien ?

Passons le titre pompeux et les figures archétypales parmi les personnages qui sont certes un peu limitantes, passons aussi le suspens du final qui est très fabriqué et pas très intéressant, je trouve l'écriture vraiment toujours aussi belle. Plus encore, la mise en scène permet à l'ensemble d'être constamment juste et percutant alors que les situations sont assez attendues. Hamagushi a toujours le goût pour les longues scènes de réunion où chaque personnage peut prendre son temps de parole et briller un instant. Il y en a plusieurs dans ce cru qui sont vraiment réussies. Plus exactement, il y en a une par côté de l'équation, et la première, celle du village, est évidemment bien plus fouillée et complexe. Cette séquence en particulier, permet vraiment d'irriguer un peu tout le reste de la narration, en présentant, un à un, chaque membre de la communauté qu'il faudra apprendre - à peut-être - découvrir. Le projet de construction de ce super camping glamour (dit "glamping", une vraie tendance pas si récente que je ne connaissais pas du tout et qui a l'air d'être un vrai fléau dans certains coins) est évidemment trop énorme, absurde pour être est vraie et pourtant cela fonctionne car porté par un duo de représentant tout penauds et timides, que l'on finit bien vite par trouver aussi attachant que les locaux. Lorsque le type avoue en se surprenant lui-même qu'il n'avais pas vécu un moment aussi fort dans sa vie que de couper une buche, et qu'il compte bien rester plus longtemps, on ne peut pas s'empêcher d'être à la fois attendri et pris de pitié. C'est ce mélange je pense qui fait aussi la force des personnages et permet de dépasser leurs situations à priori trop facilement résolues.
Si l'enjeu du film semble être de protéger l'équilibre - ou du moins une notion d'équilibre théorisée et nécessairement biaisée - entre humanité et nature, le film prend pour moi définitivement parti pour la toute puissance - mais aussi la complexité - du vivant, dans sa plus générale définition. Les séquences en forêt sont irriguées par ce thème bien violoneux à la fois beau, tragique et angoissant, qui ne cesse de fluctuer entre accords, et représente assez bien la complexité de ce paysage mouvant, de ces arbres vues en contre-plongée qui sont dès le début autant refuge apaisant que dédale menaçant, propre à la perdition et à la mélancholie. On est pas si loin d'une vision romancée - voire romantisée de la nature, avec ces accents symphoniques et le lyrisme des mouvements de caméra, avec sa faune craintive et ses arbres décharnés très efficaces visuellement -, et pourtant je trouve que le film arrive à insuffler une atmosphère vraiment forte à ses moments forestiers. Au delà de l'ambiance, il y a la patience avec laquelle le film démarre, sans dialogue, pendant un bon quart d'heure, et où tout est encore possible. La campagne c'est aussi la solitude, parfois la vie qui peut être très rude et la galère pour le moindre problème de santé... Dans ce film on voit un peu la solitude, mais peut-être du point de vue d'un scénariste (la figure du père célibataire taiseux), pas forcément très intéressante. Et pourtant je trouve que même ce personnage existe aussi, alors qu'il est très basique, car le film parvient à trouver le temps pour filmer ses gestes sans en faire trop, dans son opposition un peu factice avec les deux émissaires du capitalisme branché.
A cette opposition facile et trop rapide du romantisme de la nature et de la rapidité inhumaine de la ville, la fin du film vient répondre avec un accès de violence que j'ai trouvé à la fois innnattendu et en même temps plutôt pertinent. La vision romantique prend ici donc fin.
A noter que le(s) générique(s) sont vraiment très très courts, il me semble même pas avoir vu de véritable équipe technique créditée, j'ai rêvé ou bien ?
un entretien avec le réalisateur américain Andrew Davis
https://www.lepoint.fr/pop-culture/andr ... 5_2920.php
https://www.lepoint.fr/pop-culture/andr ... 5_2920.php
Vosg'patt de cœur
C'est tout le contraire de ce que je pense : le titre (et sa façon godardienne d’apparaitre sur l'écran) ainsi que le suspens final (rapide et sans concession) sont les deux points culminants du film (coucou M. Zvyagintsev je le met en SPOILER car c'est en rapport avec notre film ).
D'ailleurs, on peut le dire ainsi : justement, Hamaguchi est exactement le contre-exemple du cinéma moralisateur et nationaliste de Zvyagintsev : j'ai revu récemment "Le bannissement" : comment on n'avait pas vu, dans les derniers plans de ce film abject (les belles pleines éternelles de l'éternelle Russie de Poutine), tout ce qui allait se passer juste une décennie plus tard (l'invasion de l'Ukraine) ???
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub

Il y a semble-t-il dans le cinéma argentin qui est nous donné à voir ces dernières années un recours aux durées extrêmes. Je pense à Trenque Lauquen ou à La Flor (je n'en ai vu aucun des deux, seulement humé par textes et extraits) ou même à Eureka que j'ai récemment salué. Les 3h de Los Delincuentes s'inscrivent dans la même approche, mais nous force à nous interroger sur ce quasi-systématisme. Le temps long suffit-il à créer un (ou des) monde(s) (en simplifiant je crois que c'est un peu l'intention de départ de ces formes cinématographiques) ou ne devient-il pas lui aussi un certain formalisme stylistique ? Le cas de Moreno m'interroge, sans pouvoir formuler de réponse claire.
Los Delincuentes est sans doute la meilleure illustration possible d'une phrase de Deleuze qui nous disait (en parlant d'ailleurs de cinéma, de Minelli en particulier) qu'il fallait se méfier du rêve de l'autre car si on s'y retrouvait pris on était foutu. C'est exactement ce qui se passe ici : Moràn fait un rêve et y entraine de force Romàn, dont la vie périclite sans rien avoir demandé. Jusqu'à ce que Romàn se mette à rêver lui aussi, un rêve pas si éloigné de celui de Moràn, tout en l'en excluant à son tour.
Tout le long du film semble ainsi construit comme une sorte de faux double en miroir, mais dont les deux parties seraient dans l'impossibilité de reconnaitre leurs correspondances et de dialoguer l'une avec l'autre. Elles sont surtout dans l'impossibilité de s'envisager comme deux éléments qui pourraient finir par cohabiter ou par coïncider pour former un tout plus beau et plus fort.
Cette impossibilité du double ou du trouble était pourtant annoncé dès le début du film avec cette histoire de deux signatures copie-conformes renvoyant à deux personnes différentes, ce que les rouages administratifs ne pouvaient tolérer. De cette anecdote drolatique rapidement évacué, le réalisateur ne tire pourtant aucune fantaisie, aucune ouverture et préfère amuser les spectateurs avec les grincements de la chaise du patron de l'agence. Je crois qu'à mon sens Los Delicuentos fini par se caractériser par son manque de générosité et sa surprenante petitesse. Même le larcin commis par Moràn, pourtant charmant par sa modestie, fini par en être symbolique: c'est avant tout un rêve petit, un rêve pour soi et surtout pas pour les autres, ni avec les autres. Nous sommes loin du "banquier anarchiste" et surtout nous sommes loin du cinéma des années 70 dont certain croient voir ici une filiation. En effet dans les nombreuses "sorties de route", errances et divagations du cinéma d'alors, il y avait toujours quelque chose de la rencontre, du groupe, des possibles explorés à plusieurs. Et ce même si il y a, au final, un retour au normal, il y avait eu entre temps une vie et un rêve fait en commun, un rêve heureux du collectif. Des "naufragés de l'ile de la tortue" jusqu'à "Maine-Océan" (qui m'avait alors ému aux larmes de joie) c'est par exemple toujours ce qui se passe chez Jacques Rozier mais absolument pas ici. (La référence directe à L'Argent de Bresson que les personnages vont voir, me semble ainsi à la fois très juste par rapport à l'esprit du film mais aussi très en désaccord avec cette supposé filiation utopique des 70s)
Il y avait pourtant une tentative lors du début de la deuxième partie du film, lors de la rencontre avec les trois jeunes gens dont tous les prénoms sont des anagrammes, tandis que la pomme paradisiaque est croquée et que les jeux de lettres se prolongent dans des noms de villes qui s’enchâssent à l'infini. De cette proto-ouverture ne nous restera que le personnage féminin qui sera aussi le plus beau et le plus fort du film. En effet, dans cette logique qui guide le film, c'est le seul personnage qui refuse de se laisser embarquer dans le rêve des autres. La porte est claquée dès que la supercherie est annoncée, pour mieux disparaitre et aller vivre son propre rêve.
Fort heureusement, et de façon très cohérente par rapport à sa logique interne, les deux protagonistes ne se rejoignent pas à la fin du film. Moreno préfère clore son ouvrage sur un cavalier cow-boy errant dans une plaine déserte, faisant définitivement coïncider l'idée de liberté à celle de solitude, reproduisant de la sorte - et peut-être inconsciement - les mêmes shémas et mécanismes que ceux dont Moran avait voulu originellement s'extraire. Voilà un film qui se révèle donc bien plus être de son époque que ce qu'il aurait voulu nous faire croire.
Tout ce que tu dis est juste mais cela n’empêche pas le film d'avoir une espèce de filiation avec l'utopie des '70 et les films de Rozier (son humour surtout !). La jeune fille que tu évoques très justement c'est le cinéaste lui-même : le réalisateur, via son héroïne, qualifie nos deux héros de : débile (l'un) et fou (l'autre). C'est le XXI siècle qui veut ça (à mon opinion, elle a même récupéré le butin en question et s'est cassée - mais cela n'a pas beaucoup d'importance). Donc oui , le film est bien de son époque (car le cinéaste vit la même époque que son héroïne, à laquelle il s'identifie très justement), mais la filiation avec l'utopie 70 est évidente, également. A mon avis, bien surcyborg a écrit : ↑mer. 17 avr. 2024 13:27ce qui se passe chez Jacques Rozier mais absolument pas ici. (La référence directe à L'Argent de Bresson que les personnages vont voir, me semble ainsi à la fois très juste par rapport à l'esprit du film mais aussi très en désaccord avec cette supposé filiation utopique des 70s)
...
De cette proto-ouverture ne nous restera que le personnage féminin qui sera aussi le plus beau et le plus fort du film. En effet, dans cette logique qui guide le film, c'est le seul personnage qui refuse de se laisser embarquer dans le rêve des autres. La porte est claquée dès que la supercherie est annoncée, pour mieux disparaitre et aller vivre son propre rêve.
...
Voilà un film qui se révèle donc bien plus être de son époque que ce qu'il aurait voulu nous faire croire.
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
En ce qui concerne l'humour je trouve qu'il y en a tout de même assez peu, le film me parait même plutôt sombre.
Tu m'aurais dit "mélancolie" à la limite, mais humour (j'ai ri quelques fois, il est vrai) ou légèreté pas vraiment.
Ca fait partie des points qui le rende diffèrent d'une soit-disant filiation avec les années 70. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas mais qu'elle est tout de même ténue, et à mon sens encore plus ténue dans la "lecture politique" que l'on pourrait faire du film si on le souhaite.
Guiraudie, avec son dernier film surtout (Viens je t’emmène) m'en semble bien plus proche.
Quant au fait que le personnage féminin soit le point de vue du réalisateur, oui pourquoi pas en effet. Mais je crois que ça aurait tendance à me rendre le film plus antipathique encore (quoi, donc le réalisateur nous dit ouvertement qu'il nous impose de passer trois heures avec d'un côté un fou et d'un autre un débile et qu'il préfère lui même se casser pour nous laisser nous dépatouiller avec eux ? Super...).
Qu'elle puisse avoir pris l'argent avant de se tirer est intéressant, et confirmerai qu'elle est le "meilleur" (ici le plus malin, intelligent) personnage du film.
Mais alors pourquoi ne pas clore le film sur elle, ou sur un ailleurs avec elle ?
Il y avait quelque chose d'assez séduisant dans cet espèce de triangle amoureux spectral qui régit la deuxième partie du film, mais je crois que cela aurait pu déboucher sur quelque chose de plus fort.
Tu m'aurais dit "mélancolie" à la limite, mais humour (j'ai ri quelques fois, il est vrai) ou légèreté pas vraiment.
Ca fait partie des points qui le rende diffèrent d'une soit-disant filiation avec les années 70. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas mais qu'elle est tout de même ténue, et à mon sens encore plus ténue dans la "lecture politique" que l'on pourrait faire du film si on le souhaite.
Guiraudie, avec son dernier film surtout (Viens je t’emmène) m'en semble bien plus proche.
Quant au fait que le personnage féminin soit le point de vue du réalisateur, oui pourquoi pas en effet. Mais je crois que ça aurait tendance à me rendre le film plus antipathique encore (quoi, donc le réalisateur nous dit ouvertement qu'il nous impose de passer trois heures avec d'un côté un fou et d'un autre un débile et qu'il préfère lui même se casser pour nous laisser nous dépatouiller avec eux ? Super...).
Qu'elle puisse avoir pris l'argent avant de se tirer est intéressant, et confirmerai qu'elle est le "meilleur" (ici le plus malin, intelligent) personnage du film.
Mais alors pourquoi ne pas clore le film sur elle, ou sur un ailleurs avec elle ?
Il y avait quelque chose d'assez séduisant dans cet espèce de triangle amoureux spectral qui régit la deuxième partie du film, mais je crois que cela aurait pu déboucher sur quelque chose de plus fort.
Dans son cas, je dirais que Guiraudie rend plutôt hommage au cinéma qu'on évoque ensemble.
Oui, tout à fait. Car c'est l'époque qui veut ça. Il se peut qu'il n'est pas forcement d'accord avec cela, mais c'est la réalité de l'époque et le personnage feminin est tout sauf anodin. Et si nous avons passé 3 heures avec "un fou et un débile", où est le problème ? Il ne faut pas filmer les fous et les débiles ?? En réponse, tu va dire très justement : ce n'est pas ça le problème mais : à quoi bon ??cyborg a écrit : ↑ven. 19 avr. 2024 10:59Quant au fait que le personnage féminin soit le point de vue du réalisateur, oui pourquoi pas en effet. Mais je crois que ça aurait tendance à me rendre le film plus antipathique encore (quoi, donc le réalisateur nous dit ouvertement qu'il nous impose de passer trois heures avec d'un côté un fou et d'un autre un débile
C'est dans la suite :
Car ce n'est pas le personnage principal du film ! Rozier avait fait pareil, quand il clôt son "Du côté d'Orouët": il montrait le visage de Joëlle (Danièle Croisy), une de ses 3 héroïnes principales et ses magnifiques larmes, et pas Gilbert (Bernard Menez) :

Oui, mais "ça ne se fait plus" au XXI siècle. Le constat est horrible (selon moi, d'où la force du film) mais c'est bien ça la déshumanisation en cour...
"Le cinéma n'existe pas en soi, il n'est pas un langage. Il est un instrument d’analyse et c'est tout. Il ne doit pas devenir une fin en soi".
Jean-Marie Straub
Jean-Marie Straub
@sokol oui peut être que je rêve juste d'un autre film et que c'est aussi ce qui m'empêche d'aimer véritablement ce film. N'empêche il aurait été super de clore le film avec ce personnage féminin et de laisser les deux gus dans leur marasme. Bref...

Serras da Desordem - Andrea Tonacci - 2006
La récente découverte du cinéma d'Andrea Tonacci avec son film Bang Bang (1971) m'a donné envie de connaitre la suite de sa carrière. Tonacci s'être progressivement tourné vers le documentaire, quoi d'autre quand on semble mépriser aussi fort les conventions habituelles du cinéma fictionnel ? Je n'ai pour l'heure que pu trouver son dernier film "Serras da Desordem".
Mais bien sur, Tonacci ne pouvait pas non plus faire du documentaire classique et propose ici un film - et un projet - aussi hallucinant qu'halluciné, ambitieux dans son propos et dans sa réflexion.
Le réalisateur se penche sur le massacre qu'a subi la communauté indigène Awá-Guajá dans les années 70 et se concentre sur la destiné de Carapirú, seul survivant supposé, qui errera pendant plusieurs années et sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à être recueilli par une famille de brésiliens dont il partagera la vie quelques temps. Ceci jusqu'à ce qu'une organisation gouvernementale ne repère son existence et ne le renvoi fissa "parmi les siens", non sans une grande exposition médiatique au passage.
Si l'histoire est incroyable, elle est traité ici d'une façon complétement transversale, entre éléments fictionnels mis en scène, approches documentaires, documents d'archives... La plus grande partie du film est constitué d'un geste de "reenactement" durant lequel Carapirú, désormais âgé, rejoue son propre rôle, sa fuite puis sa vie quotidienne dans une "nouvelle famille" brésilienne. Eux même jouent leurs propres rôles et rejouent leurs propres gestes et interrogations d'alors, tout en ouvrant les questions vers la réalité du présent de chacun, car personne ne s'était alors vu depuis près de 20 ans.
Entre passé et présent, entre faux vrai et vrai faux, cet étrange dispositif surprenanement émouvant, croise les temporalités pour mieux interroger l'écriture de l’Histoire et la construction des identités. De mémoire, seul The Act of Killing de Joshua Oppenheimer semble pouvoir tenir la comparaison, tant le trouble généré par les deux films semblent cousins. Tonacci pousse peut-être encore plus loin son propos en ouvrant sa réflexion vers l'identité de tout le Brésil et même de notre modernité capitaliste et médiatique, sans oublier de mettre en doute son propre de geste de création. Les dernières images de Serras da Desordem sont ainsi le "making-off" de la scène d'ouverture du film qui nous présentait alors de façon naturaliste la vie des Awá-Guajá, entrainant de la sorte toute l'histoire même du cinéma ethnographique dans les interrogations du film

Black Mother - Khalik Allah
Ce qui se voulait être un documentaire expérimental sur la Jamaïque contemporaine, croisé à un journal intime filmé sur plusieurs époques, se révèle être une sorte de long clip indigent et esthétisant truffé de problèmes en tous genres (place et représentation des femmes, de la religion, de la pauvreté, racisme anti-asiatique latent...). Excellent exemple de "misery-porn" contemporain : à fuir.

Émerveillé par la découverte de Le Voyage Perpétuel, j'ai profité de la fin du cycle "Lapsuy & Markku Lehmuskallio" sur Tenk pour découvrir leur autre film le plus fameux "7 chants de la toundra".
Légèrement plus classique dans sa forme, cette œuvre est ici ouvertement une fiction. Celle-ci est composée de sept scénettes dans lesquelles se croisent différents groupes/familles de Nénètses en proie aux désirs coloniaux des soviets et à leurs planifications dévorantes. Le documentaire ne tarde pas à pointer le bout de son nez au détour de quelques plans et entre les histoires tantôt drôlatiques tantôt dramatiques qui nous sont contés ici. En résulte un incroyable document sur un peuple bien en mal de trouver un équilibre entre modernité et tradition et dont l'existence même est absolument inconnu pour la majorité de la planète.

Reason over passion - Joyce Wieland - 1969
Film expérimental à la croisé des genres. Wieland fait sienne une célèbre phrase d'un ministre canadien d'alors qui prônait "la raison au dessus de la passion". La citation est triturée à l'extrème et l'artiste la fait apparaitre à l'infini sur les images sous formes d'anagrammes toujours différents (dans le générique de fin un programmeur est d’ailleurs remercié, nous posant ici à l'orée des questions de poésie concrète programmatique, voir même de cybernétique en exagérant un peu).
En arrière plan, nous voyons essentiellement des plans de grands espaces canadien pris durant un road-trip. Les images sautent, grésillent, suivant les routes, les rivières, les lignes de crêtes, tandis que s’égrainent inlassablement les anagrammes qui s'y superposent.
Si je n'ai pas manqué de m'assoupir allégrement (1h20 à ce seul régime est un peu longuet) j'ai pu découvrir après le film que Joyce Wieland était à l'époque la compagne d'un certain Michael Snow dont l'essentiel "La vallée centrale" paraitra à peine quelques mois plus tard... Un étrange pressentiment (et traitement du son) m'avait fait songer à lui, y voyant une sorte de réponse (je mélangeais alors les dates de parution) en miroir, totalement organique et corporelle dans lequel les mouvements de caméra n'auraient rien de programmatiques et ou le territoire serait sans cesse renouvelé. Découvrant l'histoire de leur union, je me suis pris à imaginer que ces images de Wieland aient été prises durant les voyages fait avec Snow pour aller repérer/mettre en place/tourner La Vallée Centrale, faisant de chaque film un bout de la conception de l'autre et se répondant ainsi conceptuellement à l'infini. J'en suis tout chose.

Serras da Desordem - Andrea Tonacci - 2006
La récente découverte du cinéma d'Andrea Tonacci avec son film Bang Bang (1971) m'a donné envie de connaitre la suite de sa carrière. Tonacci s'être progressivement tourné vers le documentaire, quoi d'autre quand on semble mépriser aussi fort les conventions habituelles du cinéma fictionnel ? Je n'ai pour l'heure que pu trouver son dernier film "Serras da Desordem".
Mais bien sur, Tonacci ne pouvait pas non plus faire du documentaire classique et propose ici un film - et un projet - aussi hallucinant qu'halluciné, ambitieux dans son propos et dans sa réflexion.
Le réalisateur se penche sur le massacre qu'a subi la communauté indigène Awá-Guajá dans les années 70 et se concentre sur la destiné de Carapirú, seul survivant supposé, qui errera pendant plusieurs années et sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à être recueilli par une famille de brésiliens dont il partagera la vie quelques temps. Ceci jusqu'à ce qu'une organisation gouvernementale ne repère son existence et ne le renvoi fissa "parmi les siens", non sans une grande exposition médiatique au passage.
Si l'histoire est incroyable, elle est traité ici d'une façon complétement transversale, entre éléments fictionnels mis en scène, approches documentaires, documents d'archives... La plus grande partie du film est constitué d'un geste de "reenactement" durant lequel Carapirú, désormais âgé, rejoue son propre rôle, sa fuite puis sa vie quotidienne dans une "nouvelle famille" brésilienne. Eux même jouent leurs propres rôles et rejouent leurs propres gestes et interrogations d'alors, tout en ouvrant les questions vers la réalité du présent de chacun, car personne ne s'était alors vu depuis près de 20 ans.
Entre passé et présent, entre faux vrai et vrai faux, cet étrange dispositif surprenanement émouvant, croise les temporalités pour mieux interroger l'écriture de l’Histoire et la construction des identités. De mémoire, seul The Act of Killing de Joshua Oppenheimer semble pouvoir tenir la comparaison, tant le trouble généré par les deux films semblent cousins. Tonacci pousse peut-être encore plus loin son propos en ouvrant sa réflexion vers l'identité de tout le Brésil et même de notre modernité capitaliste et médiatique, sans oublier de mettre en doute son propre de geste de création. Les dernières images de Serras da Desordem sont ainsi le "making-off" de la scène d'ouverture du film qui nous présentait alors de façon naturaliste la vie des Awá-Guajá, entrainant de la sorte toute l'histoire même du cinéma ethnographique dans les interrogations du film

Black Mother - Khalik Allah
Ce qui se voulait être un documentaire expérimental sur la Jamaïque contemporaine, croisé à un journal intime filmé sur plusieurs époques, se révèle être une sorte de long clip indigent et esthétisant truffé de problèmes en tous genres (place et représentation des femmes, de la religion, de la pauvreté, racisme anti-asiatique latent...). Excellent exemple de "misery-porn" contemporain : à fuir.

Émerveillé par la découverte de Le Voyage Perpétuel, j'ai profité de la fin du cycle "Lapsuy & Markku Lehmuskallio" sur Tenk pour découvrir leur autre film le plus fameux "7 chants de la toundra".
Légèrement plus classique dans sa forme, cette œuvre est ici ouvertement une fiction. Celle-ci est composée de sept scénettes dans lesquelles se croisent différents groupes/familles de Nénètses en proie aux désirs coloniaux des soviets et à leurs planifications dévorantes. Le documentaire ne tarde pas à pointer le bout de son nez au détour de quelques plans et entre les histoires tantôt drôlatiques tantôt dramatiques qui nous sont contés ici. En résulte un incroyable document sur un peuple bien en mal de trouver un équilibre entre modernité et tradition et dont l'existence même est absolument inconnu pour la majorité de la planète.

Reason over passion - Joyce Wieland - 1969
Film expérimental à la croisé des genres. Wieland fait sienne une célèbre phrase d'un ministre canadien d'alors qui prônait "la raison au dessus de la passion". La citation est triturée à l'extrème et l'artiste la fait apparaitre à l'infini sur les images sous formes d'anagrammes toujours différents (dans le générique de fin un programmeur est d’ailleurs remercié, nous posant ici à l'orée des questions de poésie concrète programmatique, voir même de cybernétique en exagérant un peu).
En arrière plan, nous voyons essentiellement des plans de grands espaces canadien pris durant un road-trip. Les images sautent, grésillent, suivant les routes, les rivières, les lignes de crêtes, tandis que s’égrainent inlassablement les anagrammes qui s'y superposent.
Si je n'ai pas manqué de m'assoupir allégrement (1h20 à ce seul régime est un peu longuet) j'ai pu découvrir après le film que Joyce Wieland était à l'époque la compagne d'un certain Michael Snow dont l'essentiel "La vallée centrale" paraitra à peine quelques mois plus tard... Un étrange pressentiment (et traitement du son) m'avait fait songer à lui, y voyant une sorte de réponse (je mélangeais alors les dates de parution) en miroir, totalement organique et corporelle dans lequel les mouvements de caméra n'auraient rien de programmatiques et ou le territoire serait sans cesse renouvelé. Découvrant l'histoire de leur union, je me suis pris à imaginer que ces images de Wieland aient été prises durant les voyages fait avec Snow pour aller repérer/mettre en place/tourner La Vallée Centrale, faisant de chaque film un bout de la conception de l'autre et se répondant ainsi conceptuellement à l'infini. J'en suis tout chose.