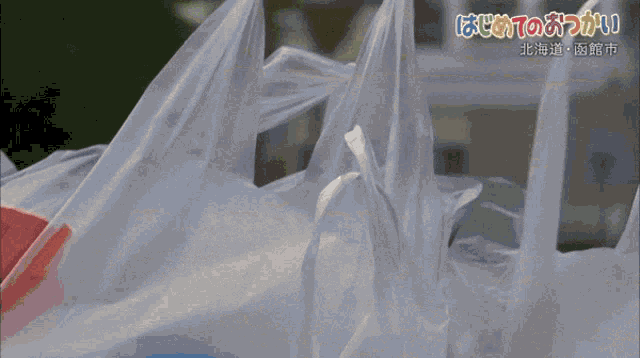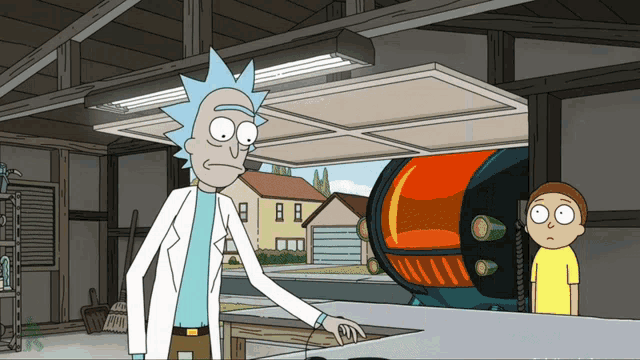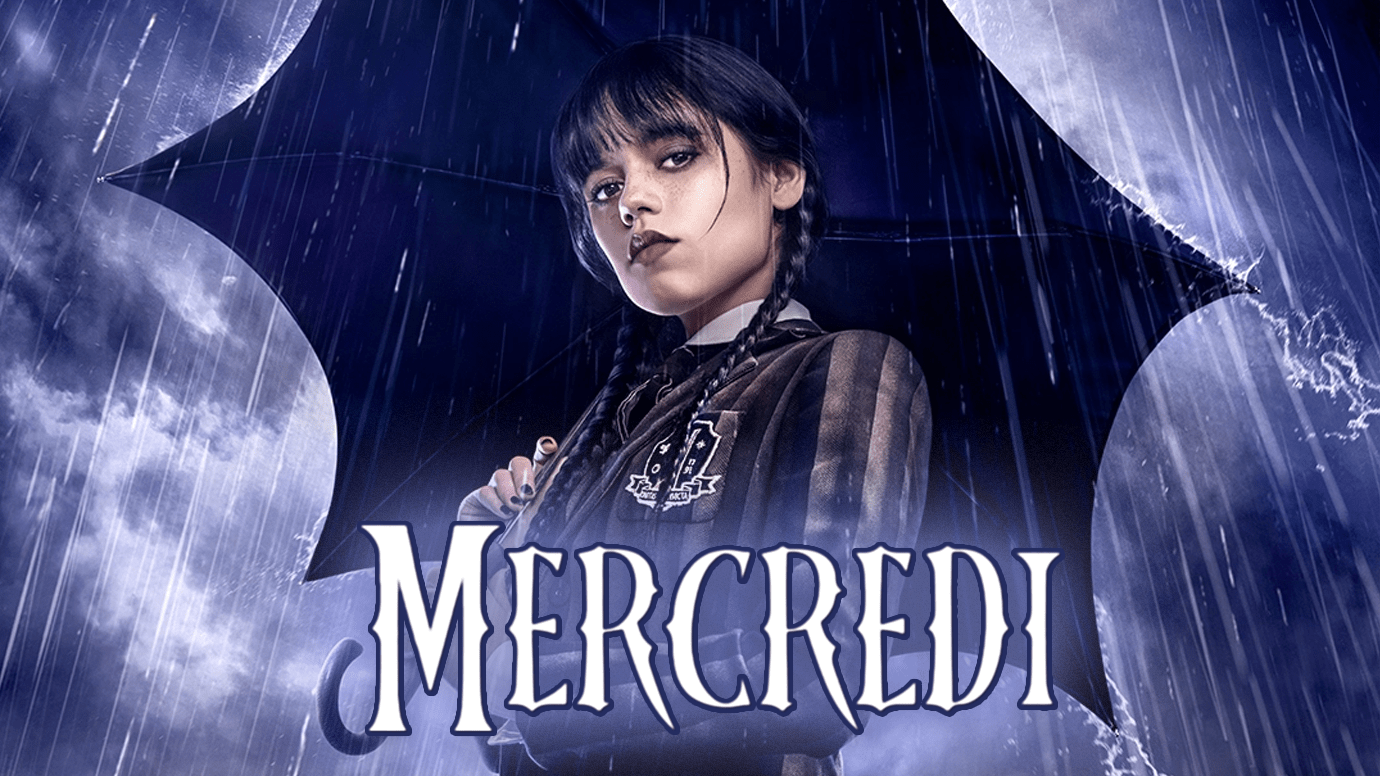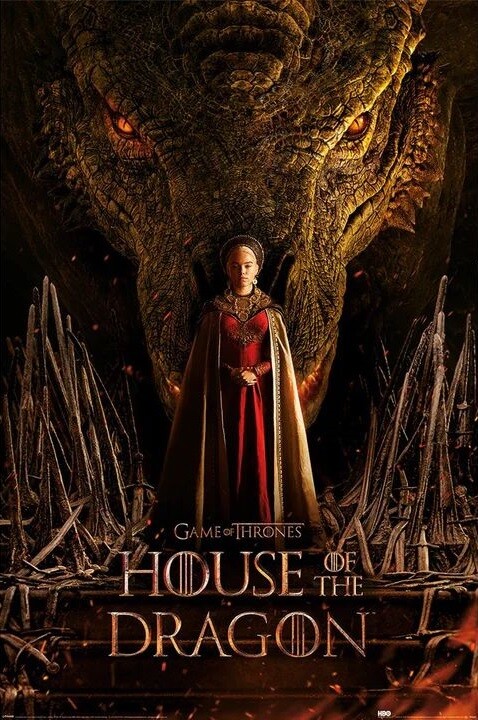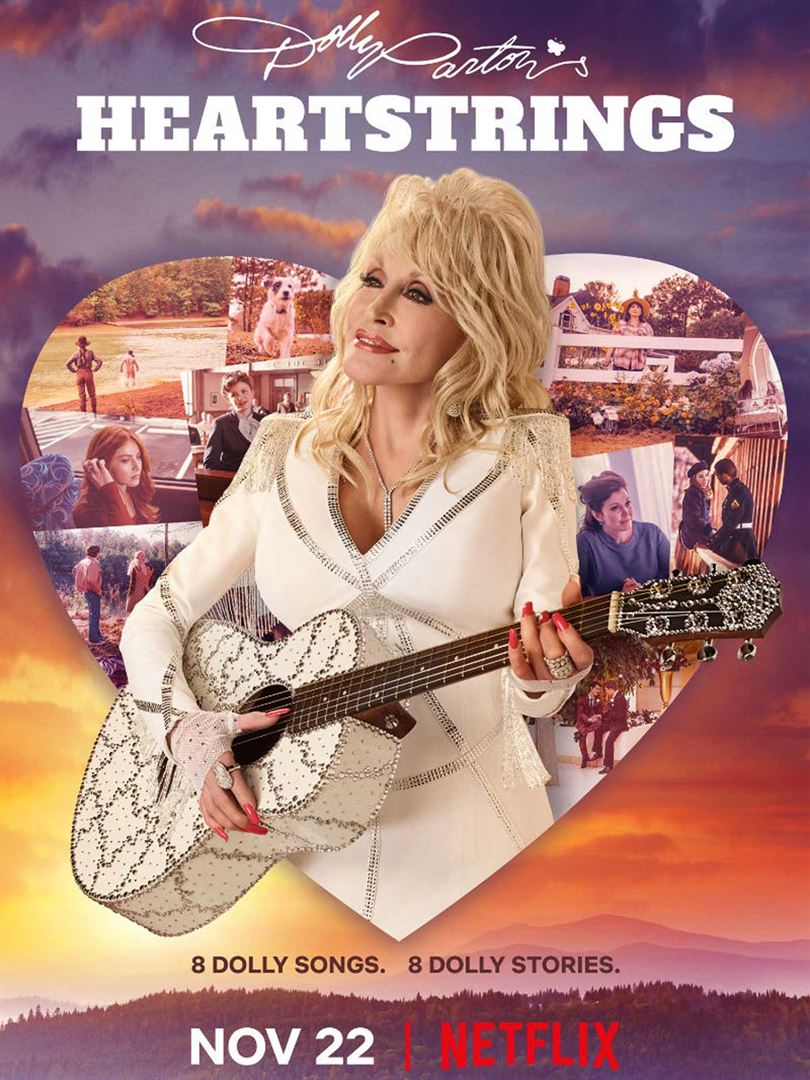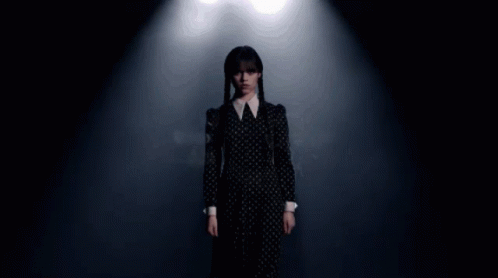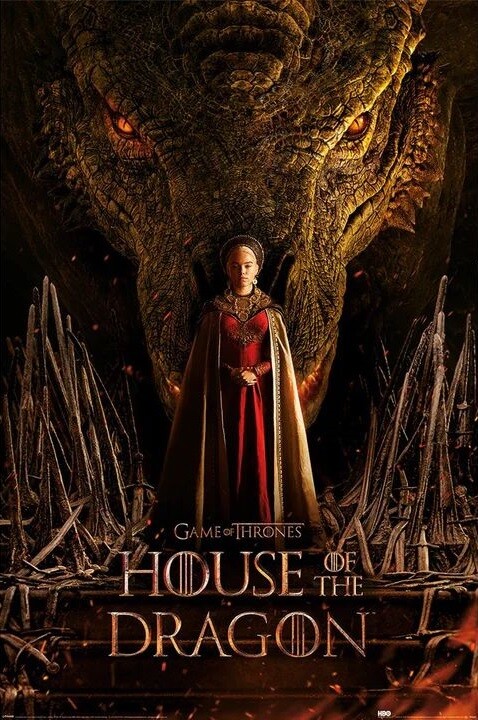
L’univers reste dans l’ensemble très similaire à celui de
Game of Thrones et il n’y a pas de changement fondamental dans la forme : les décors, l’atmosphère, les intrigues ; tout est très semblable. C’est même un peu dérangeant au début, car les premiers épisodes déploient un excès de violence gore inutile (car il n’y a pas encore d’enjeu) et de scènes de sexe (qui disparaissent d’ailleurs assez vite au fil des épisodes), comme si on voulait s’assurer que les spectateurs ne soient pas trop dépaysés. Mais c’est dans le rythme et le développement du récit et des personnages que le spin-off tire dévie de la série mère. Quand
Game of Thrones multipliait les personnages,
House of the Dragon resserre son intrigue autour des membres d’une même famille, ce qui implique que, à quelques exceptions près, on retrouve l’ensemble des protagonistes dans chaque épisode. Ceux-ci ont donc toute la place qu’il leur faut pour évoluer, et en un ou deux épisodes chacun peut avoir autant de temps de présence qu’un personnage de
Game of Thrones sur une saison entière. Qui plus est les grosses ellipses entre la plupart des épisodes leur permettent de se développer rapidement, et surtout elles renforcent l’ampleur de la série, puisqu’on saute de grand événement en grand événement, sans jamais de remplissage. Il n’est pas rare par exemple de rencontrer un personnage important dans un épisode puis de le voir mourir dans le suivant.
Mais le plus remarquable, c’est que cette ampleur dramatique se fait tout de même en sourdine, sans profusion de violence : la saison montre, sur une très longue période, la lente formation d’inimitiés et l’infusion de rancœurs, sans qu’un unique événement déclenche à lui seul la guerre. Au contraire c’est au spectateur de remplir les ellipses et d’imaginer la façon dont les antagonismes se sont renforcés. La figure centrale de Viserys apparaît d’autant plus tragique, lui qui ne comprends rien de ces désaccords et dont le seul désir est de réunir sa famille, tandis que Rhaenyra et Alicent agissent avant tout en tant que mères dépassées par le comportement de leurs enfants.
Je trouve en tout cas cette saison meilleure que la plupart de celles de
Game of Thrones, mais j’ai peur tout de même que les suivantes lui soit inférieures, notamment car le rythme reviendra à celui de la série mère et que les ellipses devraient disparaître. Mais je rêverais que la série se poursuive au-delà des personnages existants et poursuive le récit de la dynastie Targaryen sur les générations suivantes.

Très différent de
Too Old to Die Young : quand celui-ci puisait dans les films précédents de Refn (en tout cas dans ses films anglo-saxons) pour constituer un patchwork de situations, de personnages et d’ambiances et étirait les scènes plus que jamais, multipliant les temps entre les répliques et s’engouffrant dans des tunnels hypnotiques de musique,
Copenhagen Cowboy s’éloigne de ce décorum pour proposer quelque chose de plus brutal et surtout très bavard. La musique et l’esthétique léchée sont toujours présents, mais Refn prend soin de distinguer l’artificialité du bordel une fois la nuit tombée et les néons allumés de sa crudité glauque et terrifiante dans la lumière du jour : les locaux y sont aussi repoussants le jour (« un enfer sur terre ») qu’ils sont séduisants la nuit, et rien n’est caché de la vie glauque que mènent les prostituées. Les proxénètes, quant à eux, jamais glamourisés, sont représentés dans toute leur bassesse et tout leur ridicule. En résultent des premiers épisodes très oppressants, en huis-clos, dans lesquels la jeune et mutique Miu semble presque entièrement soumise à ses bourreaux. Presque, car son caractère fantastique est tout de même rapidement souligné, et il apparaît bien vite quelle est la continuation des personnages quasi-surnaturels qui se succèdent dans la filmographie de Refn : le chauffeur de
Drive, Chang dans
Only God Forgives, Yaritza dans
Too Old to Die Young… De son propre aveu, le réalisateur a voulu que
Copenhagen Cowboy soit une origin story de super-héros, et l’héroïne se retrouve rapidement icônisée, de même que ses adversaires, membres divers de la pègre plus ou moins extravagants qui se suivent sur un principe de « marabout bout de ficelle », à mesure que le cadre s’ouvre sur Copenhague.
Alors que
Too Old to Die Young introduisait une dimension politique inédite chez le cinéaste,
Copenhagen Cowboy paraît un peu plus vain, Refn semblant surtout heureux de plonger Miu dans les différents sous-mondes des bas-fonds de la ville. Le propos sur les violences patriarcales a bien sûr une place importante, mais la façon dont il est traité (hommes transformés en porcs, noblesse obsédée par le sang et la bite) vire tant dans le grotesque que le sujet ne semble pas si sérieux ici. Le récit devient d’ailleurs de plus en plus délié au fil des épisodes, jusqu’à un dernier épisode psychédélique dont l’esthétique rappelle assez
La Planète des Vampires, film de chevet de Refn mais dont il semble ici s’inspirer vraiment pour la première fois.
Le tout est souvent fascinant, rempli d’images fortes et de moments marquants, mais cette narration erratique renforce le sentiment de vacuité, qui culmine lors de la dernière scène.
Too Old to Die Young laissait aussi l’histoire en suspens, mais cela pouvait passer pour une fin ouverte, tandis que
Copenhagen Cowboy s’achève sur un cliffhanger sous forme de blague absurde, présageant une suite dont Refn sait très bien qu’elle n’aura pas lieu. C’est drôle, et au fond assez dans l’esprit des films de super-héros dont il dit s’inspirer, mais on a quand même l’impression de s’être un peu fait avoir.




 1. House of the Dragon – Saison 1, Ryan Condal et George R.R. Martin (2022)
1. House of the Dragon – Saison 1, Ryan Condal et George R.R. Martin (2022)
2.
Better Call Saul – Saison 6, Vince Gilligan et Peter Gould (2022)




 3. Copenhagen Cowboy, Nicolas Winding Refn (2022)
3. Copenhagen Cowboy, Nicolas Winding Refn (2022)
4.
We Own This City, George Pelecanos et David Simon (2022)





5.
Le Livre de Boba Fett [
The Book of Boba Fett], Jon Favreau (2021-2022)





6.
Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir [
The Lord of the Rings: The Rings of Power] – Saison 1, J.D. Payne et Patrick McKay (2022)





7.
Slippin' Jimmy, Ariel Levine et Kathleen Williams-Foshee (2022)